Augustin Leroy, un religieux français en exil en Amérique du Nord (1903-1918)
Par Simon Balloud, Université de MontréalCe texte fait partie de l’anthologie Les récits de voyage et de migration comme modes de connaissance ethnographique
Entre 1901 et 1904, les gouvernements français successifs, républicains et anticléricaux, adoptent des lois laïques qui ont pour conséquence principale la fermeture de la plupart des établissements scolaires contrôlés par des congrégations religieuses1. Dès lors, trois possibilités s’offrent aux religieuses et aux religieux qui y œuvraient: la sortie de la congrégation, la sécularisation fictive, l’exil
(Cabanel et Durand, 2005, 8). Des dizaines de milliers de congréganistes choisissent l’exil en Europe et ailleurs dans le monde (Sorrel, 2003). Le Québec accueille à lui seul environ 2 000 religieuses et religieux entre 1900 et 1914 (Laperrière, 2005, 441). Augustin Leroy est l’un d’entre eux2.
Quelques repères biographiques
Augustin Leroy – frère Marie-Auguste en religion – est né le 11 octobre 1840 à Mézeray, dans le département de la Sarthe3. Le 22 août 1856, il prend l’habit religieux au Mans au sein de la congrégation Sainte-Croix, fondée dans la même ville en 1837 par le prêtre Basile Moreau (Bergeron, 1995). Jusqu’en 1868, Leroy demeure auprès de ce dernier en tant qu’imprimeur autographe4 et secrétaire, en plus de mener ses activités d’enseignement et de surveillance au collège Notre-Dame de Sainte-Croix du Mans (t. 3: 570-5715). Les archives ne permettent pas de reconstituer le parcours de Leroy pour les années suivantes. Il évoque brièvement une année de service militaire et sa participation en tant qu’ambulancier à la guerre franco-prussienne de 1870-1871 (t. 4: 794).

Figure 1Frère Augustin Leroy (Marie-Auguste), c.s.c.
Archives de la Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix à Montréal (ACSC – Montréal), N6-1-2.
À partir de 1871, il se consacre exclusivement à l’enseignement au collège Notre-Dame de Sainte-Croix de Neuilly-sur-Seine dans le département de la Seine.
Bien que la vie religieuse et sa fonction de professeur occupent la majeure partie de son temps, Leroy entretient des relations familiales et amicales dynamiques. Ses écrits témoignent d’une admiration pour son frère aîné, Henry6, entré avant lui en religion (frère Grégoire) dans la même congrégation de Sainte-Croix et décédé en 1900. Il fréquente régulièrement ses autres frères et sœurs, ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux cousins et cousines qui vivent principalement en région parisienne, dans la Sarthe et en Mayenne. C’est d’ailleurs aux côtés de certains d’entre eux que l’enseignant se fait voyageur. Les vacances d’été et les déplacements au sein de la communauté sont souvent l’occasion pour lui de découvrir de nouveaux horizons en France, mais aussi à l’étranger. Il séjourne ainsi un mois en Italie en 1877, en Belgique avec son frère Grégoire en 1883, plusieurs semaines en Angleterre en 1889 et près de deux mois en Suisse en 1900 avec un cousin et une cousine. Le religieux relate en détail chacun de ses périples dans les carnets de notes qui l’accompagnent, démontrant ainsi un goût prononcé pour l’écriture (ACSC – Montréal, PQ235a-d).
C’est un tout autre voyage qui attend Augustin Leroy au cours de l’été 1903. Le 28 juin de cette année-là, à la suite des lois votées par la Chambre à l’encontre des congrégations enseignantes et prédicantes, les religieux de Sainte-Croix sont expulsés du collège de Neuilly-sur-Seine7. Étant donné son âge, 63 ans, la sécularisation n’est pas une option pour Augustin Leroy, qui décide plutôt d’emprunter le chemin de l’exil
et d’en faire le récit dans une série de carnets (t. 1: 18). Ce chemin le mène vers le Québec où la congrégation de Sainte-Croix est présente depuis 1847 (Balloud, 2019: 158-188) à la suite de l’invitation de l’évêque de Montréal, Ignace Bourget9. Elle s’établit d’abord à Saint-Laurent, puis essaime au Québec et en Acadie à partir de 1864.
Après un voyage transatlantique entrepris depuis Liverpool, Leroy et ses compagnons parviennent à Montréal le 28 août. Dès le 2 septembre suivant, le Français entame une seconde carrière et plus largement une nouvelle vie au collège de Saint-Césaire dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, sur la rive sud du Saint-Laurent, à une cinquantaine de kilomètres de Montréal. La congrégation de Sainte-Croix y est présente depuis la fondation du collège en 1869 (Hudon, 1996: 57).
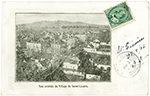
Figure 2Vue centrale du village de Saint-Césaire vers 1905
BANQ–Rosemont–La Petite-Patrie, CP 043091 CON.

Figure 3Plan d’assurance incendie de Saint-Césaire en 1906
Goad, Chas. E., BANQ, 0003030184.
D’une année à l’autre, Leroy retrouve d’une certaine manière l’existence qui était la sienne en France: l’enseignement et la vie communautaire durant l’année scolaire, tandis que les vacances d’hiver et d’été sont consacrées à la visite de proches et à des pérégrinations plus ou moins lointaines, sans jamais se soustraire à ses obligations religieuses. Sa participation au chapitre général de la congrégation à l’Université de Notre-Dame (Indiana) en 1906 est l’occasion pour lui de satisfaire une nouvelle fois son goût du voyage, sa curiosité pour l’inconnu. Ce premier chapitre de sa vie québécoise prend fin l’année suivante, en mars 1907, lorsque le religieux doit renoncer à l’enseignement à cause d’un sérieux problème de santé. C’est peu après cet événement qu’il cesse d’écrire régulièrement à propos de sa nouvelle vie. Il demeure néanmoins à Saint-Césaire, où il est toujours responsable de l’œuvre du Sacré-Cœur de Jésus, jusqu’au mois de janvier 1910.
Après sept années dans la région de Saint-Hyacinthe, Augustin Leroy est nommé secrétaire de l’œuvre de l’oratoire de Saint-Joseph au collège Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Montréal. Il travaille plus particulièrement auprès du gardien de l’oratoire, le célèbre frère André10, en l’aidant à traiter le courrier qu’il reçoit quotidiennement (Robillard, 2005a: 71 et 430). Deux ans plus tard, il fait partie de la première communauté qui réside au nouveau presbytère, à côté de l’établissement religieux (CSC, 1947: 312). En 1912, il est rédacteur adjoint des Annales de Saint-Joseph11, une publication inspirée des Annales de Saint-Joseph de Neuilly-sur-Seine, fondées en 1870, dont la publication a cessé en 1903 au moment de la fermeture du collège (CSC, 1947: 74). En 1916, Augustin Leroy figure parmi les cinq membres du nouveau conseil de l’oratoire lorsque celui-ci accède au statut de corporation civile (CSC, 1947: 94-95). Le Français demeure à ce poste et participe ainsi au développement de ce lieu imposant de la vie religieuse montréalaise jusqu’à son décès en août 1918.
Un récit polysémique
Le récit d’Augustin Leroy provient du Fonds Augustin Leroy (cotes PQ1.230 et PQ235), conservé aux Archives de la Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix à Montréal (dorénavant ACSC-Montréal). Ce fonds contient le journal personnel du Français. D’un peu plus de 800 pages, il est intitulé Quelques notes sur le voyage d’un religieux exilé: de France au Canada. Composé de quatre carnets, il couvre une période d’environ quatre ans et quatre mois, entre juin 1903 et octobre 1907 (dorénavant, t. 1, t. 2, t. 3, t. 4). C’est de ce dernier qu’est tiré l’essentiel des extraits cités.
À ce journal principal, il faut ajouter deux autres carnets de notes personnelles
qui concernent cette fois-ci la période 1905-1915, mais plus particulièrement les années 1903-1910 (dorénavant Leroy, t. I, Leroy, t. II). Rédigés de manière discontinue, ils sont constitués d’aphorismes, de copies entières ou partielles de lettres envoyées et reçues, de notes disparates. Ces carnets recèlent des informations précieuses et offrent un regard différent sur le parcours canadien d’Augustin Leroy. Vient enfin une série d’une trentaine de lettres reçues et envoyées (copies) par Augustin Leroy entre le 9 septembre 1903 et le 12 décembre 1913 (ACSC-Montréal, PQ235).
L’historien Guy Laperrière mentionne brièvement le journal d’Augustin Leroy dans les deux derniers tomes de sa trilogie consacrée aux congrégations françaises au Québec entre 1880 et 1914. Il l’utilise d’abord pour évoquer le voyage transatlantique (1999: 255-258), puis pour témoigner de l’émergence d’une spiritualité de l’exil
chez les congréganistes qui quittent la France (Laperrière, 1999: 286-290; 2005: 371-374). En effet, le sentiment d’exil a pour corollaire celui de sacrifice qui est vécu par les religieux comme une véritable épreuve spirituelle.
Augustin Leroy fait en effet de l’exil la trame narrative de son journal et plus généralement de tous ses écrits. En cela, ceux-ci s’inscrivent parfaitement dans la littérature exilaire qui se développe parmi les religieuses et les religieux qui ont quitté la France sous la contrainte au début du xxe siècle (Cabanel, 2008; Balloud, 2020). Cependant, si l’omniprésence de l’exil est manifeste, il serait réducteur de considérer que le journal de Leroy se résume à cette seule dimension. Il relève du vaste ensemble que constituent les écrits du for privé (ou ego-documents) et s’inscrit spécifiquement dans la littérature viatique, à la confluence de la relation de voyage, du récit de migration et du récit d’exil, lui conférant ainsi un caractère polysémique.
De Paris à Montréal (16 août-28 août 1903)

Figure 4Collège Sainte-Croix, Neuilly-sur-Seine, 1900
Archives départementales des Hauts-de-Seine, 9FI/NEU_155.
Après son expulsion du collège de Neuilly à la fin de juin 1903, Augustin Leroy entame ce qui semble être une véritable tournée d’adieux auprès de ses proches, d’abord à Paris, puis dans les départements de la Sarthe et de Maine-et-Loire12. Après deux semaines dans son pays natal, il se dirige vers l’Oise, l’Eure, la Haute-Marne et le Nord pour y saluer d’anciens élèves de Neuilly13. Le samedi 15 août, il parvient au Vésinet, en Seine-et-Oise14, où se situe depuis 1890 le collège Sainte-Croix.
Le samedi 15 août, j’arrive à Sainte-Croix du Vésinet, dans la soirée. Quelle pénible impression! Quel désert dans ce collège autrefois si animé. Chapelle délabrée! Autel enlevé! Appartements démeublés! Tout a été vendu avant que les spoliateurs viennent s’emparer de ce qui nous appartient (t. 1: 5-6).
Le lendemain, dimanche 16 août, il abandonne ses confrères pour en retrouver d’autres sur les quais de la gare Saint- Lazare: Larmes versées, il faut quitter la France, laisser tout ce qui attache, tout ce qui attire
(t. 1: 6).
De Paris à Liverpool
Les religieux empruntent le train transatlantique en direction du port de Dieppe, puis franchissent la Manche vers New Haven, en Angleterre.
9 heures du soir. Le train transatlantique part de Paris pour Dieppe.
Pluie toute la nuit. Vue de Rouen la nuit.
Minuit: Dieppe. Embarquement sur le bateau et quel bateau!
Tempête. [Le] vent fait passer les vagues sur le pont. Mer furieuse.
Malades: P. Lepage15, F. Paul16, F. Augustin17. Pénibles débuts!
5 heures, lundi matin, 17 août.
Arrivée à New Haven.
En wagon pour Londres, gare Victoria (t. 1: 6-7).
À Londres, ils logent à l’hôtel Dieudonné, sur Ryder Street, St James. Ce dernier est par excellence l’hôtel français de Londres
selon l’homme de lettres Émile Bergerat qui y a ses habitudes (Bergerat, 1884: 95). Il attire des marchands d’art et des écrivains de passage dans la capitale (Duret, 1906; Simon, 1952). De par sa proximité avec le St James’s Hall, il est aussi fréquenté par des artistes internationaux, tels Piotr Ilitch Tchaïkovski et Anton Rubinstein (Gordon et Gordon, 2005; Taylor, 2007). Quant à la présence des religieux, elle s’explique par un précédent séjour de Leroy et sa famille en 1889.
Avant leur départ pour Liverpool, les Français parcourent de long en large la capitale britannique.
Lundi 17 août 1903, Londres
Je loue une voiture avec interprète et, par un chaud soleil, nous visitons ce que l’immense métropole a de plus intéressant.
Agence du Canadian Pacifique; Abbaye de Westminster; Parlement; la Tamise; la Cité; Saint-Paul de Londres; Tour de Londres – Musées; Pont de Londres; N. D. de France; Square Leicester; Muséum – tableaux; Palais de Buckingham; Palais St James; Piccadilly; Hyde Parc; Monument Prince Albert; Bourse; Banque; Mansion House; Guildhall; Oxford Street; Église catholique; Green Park; Église de l’Oratoire; Statue Cardinal Vaughan; Gare Charing Cross; Post Office; Quartier des Cercles; House des Lords; Métropolitain; Omnibus; Regent Street. […].
Quelle foule!
Retour à l’hôtel. Fatigue!
Dîner. Ça se paye?
Repos dans nos chambres.
Envoi de cartes postales.
Vers 11 heures du soir, départ pour Willesden Junction.
Minuit. Nous montons dans le train pour Liverpool. Pluie toute la nuit
(t. 1: 7-10).
Le 18 août au matin, ils atteignent Liverpool après un trajet d’environ six heures. Dans son journal, Leroy inscrit à côté de la date du jour: En route pour l’exil
(t. 1: 10).
L’hôtelier annoncé qui devait nous recevoir à la gare manque.
Bagages à la main, sous la pluie, jusqu’au bureau des steamers. Bureau fermé. Une heure d’attente.
Billets de Liverpool à Montréal visés et trouvés en règle.
On se rend au port d’embarquement sur la rivière Mersey (t. 1: 10).
Sur le quai, Leroy patiente et observe les étapes successives de l’embarquement à bord du Lake Simcoe, un paquebot transatlantique de la compagnie maritime canadienne Beaver Line.
Nombreux émigrants subissent la visite du médecin et reçoivent le billet qui leur permet de partir.
9 heures. Un bateau vient chercher les émigrants pour les conduire au steamer Lake Simcoe qui remplace le Manitoba en réparation.
Nous montons sur le bateau des émigrants, croyant bien faire. Nous nous trompons.
À 11 heures, on embarque les passagers de seconde classe.
À 1 heure, ceux de première classe.
Cela nous permet de voir de près ce qu’on appelle émigrants.
Famille entière, quatre petits-enfants. Paquets, matelas, ustensiles de cuisine, malles, valises, caisses, etc.
Leur transbordement sur le steamer, Spectacle émouvant. Pauvres gens! Nous les plaignons! Cependant, eux quittent leur pays volontairement… (t. 1: 11).
Puis, c’est au tour des Français d’embarquer.
La traversée transatlantique
Libéré de ses amarres, le Lake Simcoe s’élance sur la Mersey afin de rallier le canal Saint-Georges, puis l’océan Atlantique à destination de Montréal.
À 4 heures du soir, la cloche sonne. […]. Le steamer s’ébranle et commence sa marche qui durera dix jours. Émotions, larmes! Les mouchoirs s’agitent sur les quais où se trouvent parents et amis. On leur répond du bateau.
Mes adieux à l’Europe, à la France, à ma patrie; à cette patrie qu’on aime toujours, mais qu’on chérit davantage le jour où on la perd, où on la quitte. […].
Nous longeons les quais de Liverpool, les docks, les innombrables bassins contenant des bateaux amarrés sur les deux rives de la Mersey. Quel mouvement! Quel commerce!
6 heures. Une trompette annonce le repas du soir. Nous descendons à la Dining room.
Aspect. Coup d’œil. Cuisine anglaise!
Personne ne parle ni ne comprend le français. Difficulté de nous faire servir.
Retour sur le pont. Nous sommes dans le canal Saint-Georges […].
Beau spectacle que nous quittons pour aller nous reposer. Chapelet, prières
(t. 1: 12-14).
Les voyageurs prennent rapidement la mesure de l’inconfort des cabines.
Hélas! Comment faire pour m’habituer à ma couchette, à ma cage à lapins, car mon lit me donne à peine assez d’ouverture pour m’y étendre. Je ne puis remuer dans cette caisse, impossible de lever la tête sans frapper le lit au-dessus. J’étouffe dans mon dortoir, au bout d’un quart d’heure, je quitte ma couchette, je prends mon très maigre matelas que je mets par terre et moi dessus, enroulé dans ma couverture (t. 1: 14).
Le jour, les religieux fréquentent les lieux de vie commune, notamment au moment du service des repas, et se promènent sur le pont du navire.
Mercredi 19 août 1903, 2e jour à bord du Lake Simcoe
Tout est spectacle sur un pont de vaisseau, tout est distraction sur un navire: l’oiseau qui passe, le gros poisson qui saute, le vaisseau lointain qui approche, les amusements des jeunes gens, les jeux enfantins des bébés, le vent qui souffle en tempête, le travail des matelots, les vagues qui courent sur le pont, les concerts du soir donnés par la jeunesse; tout cela chasse l’ennui et raccourcit les jours.
Nos deux confrères Paul et Augustin ne peuvent résister aux secousses du vaisseau. Leur petit cœur est malade pour la deuxième fois. Je tiens bon, mon estomac d’autruche rend jaloux ceux qui payent leur tribut à la mer. […].
Repas peu confortables pour nos goûts français. J’achète une bouteille de vin pour nos repas. Cela nous réconforte. Un peu cher: 2.50 francs. Vin Saint-Julien, Bordeaux (t. 1: 16-18).
Comme l’ensemble des passagers, les religieux déambulent à bord, observent les scènes de vie qui s’y déroulent et côtoient les autres migrants.
Jeudi 20 août 1903, 3e jour à bord du Lake Simcoe
Les émigrants sur le pont inférieur chantent, dansent, font la fête. Les pauvres gens ont raison de se distraire, car leur installation, presque à fond de cale, n’est guère confortable. Je les regardais en les plaignant, lorsqu’un matelot vient nous dire dans un langage bariolé que nous ne sommes pas à notre place. C’est le pont des premières, nous devons aller sur le pont des émigrants (t. 1: 19).
Les Français s’accommodent mal de leur statut de voyageurs de seconde classe.
Nous, nous ne descendrons pas dans un endroit si peu convenable, je vais en parler au capitaine.Telle fut ma réponse. Nous n’étions pas les seuls dans ce cas.Le jour même, j’écris au capitaine. Pas de réponse. Donc, qui ne dit rien consent. Je loue des pliants pour nous asseoir. On nous a refusé des fauteuils (t. 1: 19-20).
Au fur et à mesure que le temps s’égrène et que le vaisseau s’enfonce au cœur de l’océan, le sentiment d’exil gagne Leroy et se déploie sous sa plume.
Vendredi 21 août 1903, 4e jour à bord du Lake Simcoe
Je pense à la France que j’ai quittée, et au Canada vers lequel je vogue. Pensées tristes; que me réserve l’inconnu? Je verse quelques larmes au souvenir de la patrie. Lorsque les vagues venaient se briser sur le navire, elles me rappelaient le dernier embrassement donné à ma famille, à mes amis, et mon cœur ému m’éloignait de la réalité. Quelques cris joyeux me font sortir de ma rêverie. Ce sont de tout jeunes enfants qui, les blonds cheveux au vent, jouent sur le navire.
La mer est redevenue calme. Beau soleil.
Quelques dames écrivent sur leurs genoux. Beaucoup de passagers, comme nous, du reste, lisent et regardent (t. 1: 21-22).
Dans le journal du prêtre, la première personne du pluriel, nous
, cède régulièrement place à la première personne du singulier, je
. En cela, son attitude s’inscrit dans un phénomène caractéristique du xixe siècle, où le
(Lyon-Caen, 2016: 169). je
et ses soupirs sont partout: effusion amicale ou amoureuse, tendresse familiale, exaltation face aux sublimités de la nature, scrutation inquiète du moi
dans l’histoire
Le 22 août est l’occasion pour Augustin Leroy de se rappeler une date importante de sa vie religieuse.
Samedi 22 août 1903, 5e jour à bord du Lake Simcoe
À ce même jour, le 22 août 1856, je recevais dans la chapelle de Sainte-Croix du Mans le saint habit religieux des mains de Mgr Nanquette18, évêque du Mans, grand ami de notre petite congrégation.
Si je l’avais eu cet habit religieux, je l’aurais baisé avec respect, c’est lui qui me vaut la persécution, c’est lui qui me vaut l’exil, temps béni qui me rapproche de Dieu (t. 1: 23).
Sur le pont qu’il arpente quotidiennement, Leroy adopte une attitude spectatoriale
face aux beautés du monde voulu par Dieu telles qu’elles se déploient sous les yeux du chrétien zélé
(Corbin, 2014: 48). Le ciel et la mer – et plus largement la nature, le monde – se muent en un ballet divin, celui de la Création. Comme Chateaubriand avant lui, Leroy en livre un récit empreint d’un certain romantisme où la preuve de l’existence de Dieu se trouve dans les merveilles de la nature
(Chateaubriand, 1826: 189)19.
La tempête ne cesse pas. Le bateau file lentement, penché à bâbord. Je veux jouir du spectacle qu’offre la mer en furie. Le pont est balayé par les vagues. Il faut se tenir accroché aux cordages. Impossible de rester sur le pont. Spectacle bien capable de faire comprendre la puissance du divin créateur, et son extrême bonté en permettant à une faible nacelle de braver le courroux du terrible élément! (t. 1: 25).
Leroy et ses compagnons pratiquent leurs exercices religieux dans leur cabine et récitent leur chapelet lors des promenades sur le pont. Pour la messe, il faut attendre le dimanche.
Dimanche 23 août 1903, 6e jour à bord du Lake Simcoe
Grand calme dans la nature.
Prompte toilette du matin, prière et vite sur le pont.
Les colères maritimes cessent comme celles des mortels.
Tous les passagers sont en habits du dimanche.
10 heures. Office pour les sujets protestants dans le salon des premières.
11 heures. Office catholique dans la salle à manger. Chants en anglais, debout. Piano tenu par le maître d’hôtel. Soixante personnes et plus. Bonne tenue. Sermon en anglais par un prêtre parti avec nous de Liverpool. [Il] s’est entretenu plusieurs fois, en latin, avec le P. Lepage. Une prière pour remercier le Bon Dieu de sa visible protection depuis notre départ de France.
Très belle soirée jusqu’à 5 heures […].
Le coucher du soleil est plein de charme, ce soir. L’astre à demi plongé dans la mer, là-bas à l’horizon lointain, nous envoie ses rayons rougeâtres que le mouvement des flots divise en longues parcelles de toutes couleurs. À un certain moment, la mer moutonne, et chaque petite vague reflète les derniers feux du soleil qui disparaît en laissant un crépuscule que nous admirons longtemps.
Ce beau spectacle nous porte à la prière. Nous récitons notre chapelet (t. 1: 26-27).
Le lendemain, Leroy flâne sur le pont et se laisse envahir par la nostalgie, non sans rappeler, une nouvelle fois, Chateaubriand et ce qu’il nomme l’instinct de la patrie
(Chateaubriand, 1826: 264-274).
Mardi 25 août 1903, 8e jour à bord du Lake Simcoe
Un grand steamer se voit sur la même ligne que nous. Vient-il de France? Souvenirs évoqués. Ma famille, Neuilly, mes élèves, mes amis, les scènes de départ. Soirée délicieuse. Ciel admirablement pur. Les vagues poussées par le vent viennent caresser le navire, quelques-unes plus hardies pénètrent sur le pont. Ce bruit des machines qui m’agaçait les premiers jours me paraît plus supportable, j’aime maintenant son tapage rauque et cadencé, peut-être trouverai-je charmant et agréable le tic-tac du navire qui me ramènera en France!
Cette soirée tranquille porte à la rêverie. Je suis songeur, je lis, je regarde, je pense à ceux que j’ai quittés, je pense à ceux qui m’ont précédé au Canada. Que ferai-je désormais? Que fera-t-on de moi? […]. Que mon sacrifice serve pour la sanctification de mon âme, pour l’expiation de mes péchés, pour le salut de la France et pour le bon renom de notre petite congrégation (t. 1: 32-33).
À l’approche des côtes, la description du paysage reprend.
3 heures. Nous sommes en face d’une ligne noirâtre qui apparaît à notre droite, ce sont les îles Saint-Pierre et Miquelon.
Les petites barques à voilent deviennent plus nombreuses; le brouillard, qui s’épaissit rapidement, les fait disparaître à nos yeux. Quelques phares dominent les rochers et, bientôt, îles, rochers et phares sont cachés par le brouillard intense qui enveloppe notre maison flottante et si fragile (t. 1: 33-34).
Le mercredi 26 août, le paquebot croise au large de l’île du Cap-Breton, puis d’Anticosti, avant de s’engager dans l’estuaire du Saint-Laurent: En arrivant sur le pont, nous apercevons quelques îlots, puis plus loin une grande île à notre gauche. […] Salut à la terre d’Amérique! […] Le golfe du Saint-Laurent se montre dans toute sa splendeur
(t. 1: 36).

CarteVoyages d’Augustin Leroy en Amérique du Nord de 1903 à 1918
Vers Montréal
Le Lake Simcoe fend donc enfin les flots du Saint-Laurent après huit jours de traversée. La remontée du fleuve jusqu’à Montréal, lente et dangereuse, prend presque trois jours.
Mercredi 26 août 1903, 9e jour à bord du Lake Simcoe
L’impression que nous ressentons est impossible à décrire. Si je faisais la description exacte de ce beau fleuve, j’épuiserais votre patience sans jamais lasser votre admiration. Nous sommes à quelque distance de la rive gauche, la rive droite est à 20 ou 25 lieues plus loin. Les eaux commencent à changer de couleur, l’immense quantité d’eau fluviale qui arrive se confond avec l’océan. Les vagues s’apaisent, se reculent et les flots d’un bleu azur permettent à notre vaisseau de glisser tranquillement au milieu d’un décor incomparable. Rives boisées, prairies verdoyantes, collines cultivées, forêts épaisses couvertes de sapins, de bouleaux, de chênes et de beaux arbres dont le feuillage nous est inconnu. La brise matinale nous apporte des odeurs d’herbe et de sapin qui nous exaltent, qui nous réjouissent après huit jours de mer […].
Toutes les cabines sont désertes, les passagers ne veulent rien perdre du merveilleux panorama qui se déroule à leurs yeux (t. 1: 38-39).
Le paquebot s’immobilise en face de Rimouski le lendemain matin. Pointe-au-Père est le premier arrêt pour les transatlantiques20.
Jeudi 27 août 1903, 10e jour à bord du Lake Simcoe
Notre bateau, pour la première fois depuis dix jours, est arrêté. […] Le steamer est en face de Rimouski, sur la rive droite du fleuve. C’est là qu’on dépose les lettres écrites sur le bateau. Parlez, petites missives, allez dans notre chère patrie, allez dire à notre vénéré Supérieur général que ses enfants, soumis à ses cadres, se rendent là où la Providence les mène. Allez saluer nos bien-aimées familles, nos chers parents, et dites-leur que notre cœur n’oublie pas ceux qu’il aime!
Une petite chaloupe se dirige vers le Lake Simcoe; c’est le pilote chargé de conduire le steamer jusqu’à Montréal. On le hisse à bord. […]. Le navire reprend sa marche silencieuse (t. 1: 42-43).
Depuis le pont, les religieux observent les villas et les beaux hôtels sur le bord du fleuve. Au début du siècle, le Bas-Saint-Laurent est un lieu de villégiature prisé par la bourgeoisie de Québec et Montréal (Dubé, 1986).
À l’approche de Québec, les migrants se préparent à débarquer.
Les émigrants savent que cette ville est leur point d’arrêt, aussi ont-ils revêtu leurs habits de fête. Coup d’œil original… Ils apportent leurs paquets sur le pont, et quels paquets! (t. 1: 44).
En fin d’après-midi, alors qu’ils longent la rive nord du Saint-Laurent, le navire cesse de nouveau sa course pour permettre l’inspection d’un médecin du Lazaret de la station de quarantaine de la Grosse-Île (Kelley et Trebilcock, 1998: 49-50).
Cette visite commence par les habitants des cabines de première classe. Les passagers de seconde classe se rendent dans la salle à manger et passent un par un devant le docteur qui est très sympathique pour les cinq religieux français proscrits de leur patrie (t. 1: 48).
Enfin, le navire se présente devant Québec.

Figure 5Vue de la ville de Québec depuis un bateau à vapeur, vers 1890
Musée McCord, VIEW-2594.
Au fur et à mesure que nous approchons de cette ville, des cris d’admiration se font entendre. Le soleil, dont le disque s’est élargi, encadre de ses rayons ce promontoire enchanteur. La grandiose construction du château Frontenac nous apparaît dans toute sa beauté. Plus haut encore, la citadelle se détache sur un ciel couleur de feu. Les maisons de la basse ville s’illuminent […], les innombrables fenêtres de l’hôtel Frontenac brillent successivement. […] Le coup d’œil est vraiment féerique, et cet aspect est inoubliable.
Il est sept heures. Nous entrons dans le port. […] Les émigrants qui se dirigent tous vers le Manitoba débarquent. Défilé pittoresque jusqu’au hall qui va les abriter pour attendre le train de Winnipeg21 (t. 1: 51-52).
S’ils le souhaitent, les autres passagers bénéficient de quelques heures pour visiter la cité, ce qui n’est pas le cas des Français qui préfèrent demeurer à bord. Ce manque d’intérêt peut surprendre, tant l’ancienne capitale de la Nouvelle-France et plus vieille ville du continent attire les voyageurs français en visite au Canada (Simard, 1987: 121).
Le lendemain, le navire appareille pour Montréal.
Vers 4 heures du matin, je sens que le bateau remue, il va quitter le port. […] Le F. Paul se lève et moi aussi. Nous voulons jouir du jour naissant et saluer Québec […].
Beau lever du soleil. Villages à droite et à gauche. Ce n’est plus comme de la mer à Québec, le pittoresque des caps et des falaises, c’est la beauté d’une plaine infinie toute parsemée de villages aux maisons blanches, de clochers plus ou moins brillants suivant la hauteur du soleil dans sa course céleste. Le son d’une cloche retentit à nos oreilles. Nous récitons l’Angelus […].
Quelques clochers gardent encore sur le haut de la croix le coq gaulois, symbole de la vigilance. Nous sommes bien en pays français! (t. 1: 54)22.
Le navire dépasse Trois-Rivières, traverse le lac Saint-Pierre, longe Sorel et l’embouchure de la rivière Richelieu. Sur le pont, matelots et passagers s’activent alors que Montréal est en vue.
On commence à monter les bagages sur le pont. On jette à l’eau les caisses vides, les sacs remplis de déchets (t. 1: 57).
À Montréal

Figure 6Vue du port de Montréal depuis la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, vers 1900
Musée McCord, VIEW-3212.1.
Le vendredi 28 août, le navire arrive enfin à quai et déverse une foule de passagers dans la ville.
Il est 5 heures du soir. Une foule compacte se trouve sur les quais. Les chapeaux s’agitent, les mouchoirs voltigent, les amis se reconnaissent et s’interpellent (t. 1: 58).
Les religieux constatent assez rapidement qu’eux ne sont pas attendus.
Nous cherchons des yeux ceux qui nous attendent ou quelques figures de connaissance. Nous ne voyons personne. Nous laissons passer presque tous les passagers du bateau, espérant toujours voir arriver à notre rencontre nos confrères du collège Notre-Dame-des-Neiges. Nous attendons en vain. Un peu désappointés, nous prenons nos valises à la main et nous nous dirigeons vers le hall de la douane pour la visite des bagages. […] L’employé fait ouvrir une valise. Je lui dis que toutes les autres sont ainsi composées et que nous arrivons de France, religieux proscrits. […] (t. 1: 58-60).
Ils décident donc de recourir au service d’un fiacre pour les conduire dans le quartier Côte-des-Neiges où ils doivent retrouver leurs coreligionnaires. C’est l’occasion pour eux de découvrir Montréal.
L’impression que nous ressentons en voyant Montréal n’est pas à son avantage. Les rues ne sont que médiocrement propres et les lourds poteaux télégraphiques placés au bord du trottoir sont vraiment bien disgracieux. Cependant, nous passons par de belles avenues aux maisons construites dans le genre anglais […].
Nous passons à côté d’un beau cimetière dont l’entrée est monumentale […]. De superbes villas s’étagent de distance en distance sur la colline, et le coup d’œil sur la ville voilée par le crépuscule attire et retient nos regards (t. 1: 61-62).
Au carrefour du chemin de la Côte-des-Neiges et du chemin Queen-Mary, ils aperçoivent leur destination.

Figure 7Collège Notre-Dame pour garçons, Côte-des-Neiges, Montréal vers 1910
Musée McCord, MP-0000.853.1.
Enfin, voici une belle et immense construction située à mi-côte, c’est le collège Notre-Dame des Neiges. Des cris de surprise, rendus bientôt joyeux, nous accueillent dans la cour d’honneur et immédiatement nous sommes entourés par nos frères de France […] et par nos confrères canadiens qui finissaient la récitation de leur chapelet (t. 1: 63).
Après un long voyage, les nouveaux arrivants ne traînent pas et, à la suite d’un repas tout à fait apprécié
, ils sont heureux de retrouver de vrais lits pour dormir
(t. 1: 63).
Le lendemain, Leroy se réjouit encore de l’accueil de ses confrères.
Entourés comme nous le sommes, de bienveillants confrères parlant la même langue que nous, essayant déjà par leur amabilité de nous faire oublier ce mot terrible: exil! Nous sentons vivement que nous foulons le sol d’une seconde France (t. 1: 64).
Le même jour, le journal La Patrie annonce avec enthousiasme l’arrivée du groupe de religieux de Sainte-Croix:
Quinze religieux de la même congrégation, chassés par l’odieux gouvernement de sectaires qui régit en ce moment la France, viennent d’arriver à Montréal […]. Leur arrivée est une réjouissance. Qu’ils soient les bienvenus parmi nous; sur cette terre de liberté et de foi ils trouveront des cœurs amis et le respect des droits de tous (La Patrie, 29/08/1903: 10).
Après les retrouvailles, les Français doivent attendre que le provincial leur indique leur nouvelle obédience. Durant cette période, ils visitent le collège et explorent l’ensemble du site avec un certain émerveillement. Ils découvrent successivement le scolasticat, le juvénat, l’infirmerie, le grand jardin, le parc et la ferme23. L’excursion continue au collège Saint-Laurent qu’ils rejoignent grâce au tramway électrique. Au presbytère, les Français rencontrent le père Georges Dion, supérieur provincial depuis 189624. C’est l’occasion de dîner à la française
et de visiter, dans une rue voisine, la maison occupée par les premiers religieux de Sainte-Croix français venus en 1847. Ils se recueillent également au cimetière où reposent plusieurs frères que Leroy a connus en France (t. 1: 66).
Le lendemain, la vie communautaire reprend dans un nouvel environnement.
Tout est nouveau pour nous: dortoir, malle au pied de chaque lit, repas au régime canadien, […], salle de récréation, théâtre, cour d’hiver, cour d’été, système de chauffage, tuyaux, pas de clôture, liberté. Ce n’est pas une liberté ébréchée comme en France (t. 1: 66-67).
Leroy s’interroge quant à sa future obédience, tout en réaffirmant son devoir d’obéissance.
Tout me portait à croire que je serais employé au petit collège de Notre-Dame des Neiges, mais le frère Théophile me fait comprendre que je suis destiné ailleurs. Me considérant, désormais, comme une feuille détachée de l’arbre et que le vent pousse où il veut, je me confie, les yeux fermés, à la Providence, faisant taire mes goûts et me promettant de ne rien demander, de ne rien refuser (t. 1: 67-68).
Le 31 août, les nouveaux arrivants connaissent enfin leurs obédiences respectives.
Dans la matinée, réunion au collège de Notre-Dame des Neiges. Le Révérend Père Provincial va nous assigner nos futures résidences: Révérend Père Lepage: Notre-Dame des Neiges; frère Marie-Auguste: Saint-Césaire; frère Paul-de-la-Croix: Sorel; frère Augustin-Marie: Saint-Césaire; F. Alexandre: Farnham. Le frère Hilaire reçoit son obédience pour Memramcook (t. 1: 68).
Le jour même, les exilés prennent la route de leurs nouvelles résidences, non sans tristesse, après deux semaines de vie commune.
À quatre heures, le frère Évariste se présente pour nous conduire à la gare Bonaventure. […] À cinq heures et quart, le frère Paul nous quitte en pleurant. Nos larmes répondent aux siennes. Nous ne partons que plus tard. Profonde émotion. Nous étions ensemble depuis quinze jours. Une séparation d’amis sur le sol étranger. S’en aller vers l’inconnu… Que c’est triste! À six heures, départ pour Saint-Césaire (t. 1: 69).
Le soir, Augustin Leroy arrive à destination.
À sept heures et demie, arrivée à Saint-Césaire. […] Il y a foule à la gare. Est-ce pour nous voir? Peut-être! La curiosité est de tous les pays. L’accueil est plutôt sympathique. Nous sommes Français et nous sommes exilés! Paternellement reçus à l’entrée du collège par le révérend père Léonard, supérieur. Tous les confrères canadiens viennent nous saluer d’une façon si aimable que, de suite, nous sommes conquis (t. 1: 70).
Saint-Césaire (août 1903-juillet 1906)
Lorsque Leroy le découvre, le collège de Saint-Césaire est dirigé depuis un an par un Canadien français, le père Léonard Bissonnette. Il compte une vingtaine de professeurs pour environ 300 élèves (CSC, 1947: 230). Dans un contexte d’industrialisation et d’exode rural, il offre à ses pensionnaires un cours commercial. Cette extension du cours primaire est de plus en plus répandue dans les établissements scolaires dirigés par des frères enseignants à partir du dernier tiers du xixe siècle, notamment dans la région montréalaise et à Québec (Turcotte, 1988; Croteau, 1996; Bienvenue, 2009).

Figure 8Collège de Saint-Césaire, Québec, vers 1910
Musée McCord, MP-0000.1028.11.
Année scolaire 1903-1904
L’installation du frère Marie-Auguste débute par un retour à l’habit religieux.
Mercredi 2 septembre 1903
Nos malles n’arriveront que le 23 de ce mois et nos habits religieux sont dedans. La rentrée ayant lieu ce soir, on nous prête des soutanes. Deo gratias […], j’étais en habits laïques depuis notre expulsion de Neuilly le 28 juin 1903 (t. 1: 71).
Le lendemain, le nouveau professeur découvre sa classe de 3e année de français.
Jeudi 3 septembre 1903
Je suis installé professeur de 3e année de français. 42 élèves de 12 à 18 et 23 ans. […] Mes impressions: débuts pénibles pour moi; sympathie compatissante des élèves (t. 1: 72).
Ses premiers mois à Saint-Césaire sont bien occupés et cela se traduit par des prises de notes de plus en plus espacées dans son journal. Entre le 10 septembre et le 18 novembre, seules quelques lignes sont écrites au sujet d’une promenade à la campagne.
En effet, le Français participe à la création de l’Écho de Saint-Césaire, un journal qui doit contribuer à la préparation d’un conventum en 1904 – après lequel il disparaîtra – en s’adressant aux anciens du collège (CSC, 1947: 228). Dans le même contexte, le supérieur le charge de rédiger un historique de la paroisse de Saint-Césaire et du collège (Leroy, 1904).
Vendredi 27 novembre 1903
Je vais à l’évêché de Saint-Hyacinthe pour consulter les archives, registres, etc. […]. Dîner à l’évêché. Je fais une visite à quelques dominicains français25 (t. 1: 74-75).
Leroy reçoit depuis la France des lettres de soutien de son supérieur général, Gilbert Français, qui l’invite à s’investir pleinement dans son travail.

Figure 9Le très révérend père Gilbert Français en 1896
Marie Auguste, frère, C.S.C., Historique de la paroisse de St-Césaire et de son collège, suivi du Rapport des fêtes du conventum, 1904, p. 97. BANQ, 0005515542.
Vous aurez besoin d’un grand courage pour ne point vous souvenir trop au vif de la France et de Neuilly. Plongez-vous dans l’occupation de chaque jour, de manière à vous absorber. Il n’y a pas d’autre moyen plus efficace pour échapper à la force de l’imagination (Français à Leroy, 09/09/1903, PQ1.230).
Les élèves bénéficient de seulement quelques jours de vacances pour le jour de l’An, où ceux qui le peuvent retrouvent leur famille. Leroy en profite pour visiter ses confrères français qui œuvrent non loin de là, comme à Saint-Aimé.
Samedi 2 janvier 1904
Je vais à Saint-Aimé avec le F. Alexandre. F. Augustin redoute la température glaciale. Très grand froid. Nous trouvons à Saint-Aimé les frères Raphaël26 et Paul de Sorel […].
Dimanche 3 janvier 1904
Visite de la ville.
Lundi 4 janvier 1904
Promenade sur la rivière Richelieu. La glace épaisse emprisonne les bateaux, steamboats et steamers. En traîneau pour traverser le fleuve Saint-Laurent de Sorel à Berthier. Impossible à cause du froid intense, 42 degrés au-dessous de zéro. La figure de F. Paul verdit, la mienne tourne au bleu et je sens mes membres s’engourdir. Il faut rebrousser chemin. Le soir à 4 heures, départ pour Saint-Césaire. Neige abondante qui encombre la voie et le convoi. La neige devient glaçon dans les roues du wagon et de la locomotive. On peut avancer (t. 1: 76-77).
L’année scolaire se termine par le conventum des anciens élèves du collège entre le 20 et le 22 juin.

Figure 10Groupe d’anciens élèves réunis dans le parc du Collège à l’occasion des fêtes du conventum de 1904
Marie Auguste, frère, C.S.C., Historique de la paroisse de St-Césaire et de son collège, suivi du Rapport des fêtes du conventum, 1904, p. 163. BANQ, 0005515542.
Été 1904
Du 4 au 9 juillet, Leroy parcourt l’ouest de l’île de Montréal, notamment l’île Bizard, depuis le noviciat de Sainte-Geneviève27 où il réside. La semaine suivante, il participe à une retraite prêchée par un père jésuite à Saint-Laurent. Les 17 et 18 juillet, il visite Montréal en compagnie d’autres religieux.
Nous montons sur le plateau du mont Royal. Vue splendide sur la ville de Montréal encadrée de verdure. Le fleuve Saint-Laurent se déploie majestueusement […]. Nous allons visiter l’installation du funiculaire28. Promenade dans les allées du mont Royal dont Paris ferait un paradis terrestre.
Après un bref retour à Saint-Césaire, le début du mois d’août est consacré à un pèlerinage à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.

Figure 11Le vapeur Trois-Rivières, fleuve Saint-Laurent, 1910
Musée McCord, VIEW-4796.
Lundi 1er août 1904
Nous attendons le bateau de Chambly […]. Steamboat Trois-Rivières. 1 120 pèlerins […]. Parcours splendide éclairé par une lune brillante. Rien de plus beau que ce voyage, le soir, lorsque le fleuve, si majestueux par lui-même, est illuminé des feux rougeâtres du soleil noyé dans le lac Saint-Pierre.
Fleuve tout parsemé de bouées, de phares lumineux et d’innombrables petits flambeaux qui ne sont autres que les étoiles du beau ciel bleu, dont l’éclat scintillant est reflété par les ondes limpides […].
Cabines pour Messieurs les curés. Matelas étendus dans l’endroit réservé aux prêtres et aux religieux. Je m’installe dans un fauteuil. Je vais souvent sur le pont. Nous voguons vers la France! (t. 1: 88-89).
Le vapeur rallie sa destination le lendemain matin à 8 h.
Mardi 2 août 1904
Arrivée à Sainte-Anne. Messe. Communions très nombreuses. Procession dans le square. Foi, piété. Maison des pères rédemptoristes. Cordiale et charitable réception. Visite du village. Couvent des sœurs franciscaines à mi-côte. Superbe vue.

Figure 12Intérieur de la basilique Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, vers 1910
Musée McCord, MP-0000.1204.4.
Départ de Sainte-Anne à 1 heure de l’après-midi. Arrêt à Québec à 3 heures. Nous avons deux heures pour visiter la ville. Nous prenons une voiture. Aspect de la ville: vieilles rues; position pittoresque sur un rocher; cathédrale; évêché; hôtel Frontenac; terrasse. De cette merveilleuse terrasse, coup d’œil admirable sur Lévis, le Saint-Laurent, le port, la ville basse, etc. Visite de la citadelle; le parlement; le couvent des sœurs franciscaines; la Grande Allée; la porte Saint-Louis, etc.
Départ de Québec à 5 heures et demie. Rives enchantées. Palais du gouverneur. Pont qui se construit sur le fleuve. Cantiques, chants, prières. Repos de la nuit. Aurore. Lever du soleil (t. 1: 90-91).
Le 4 septembre, Leroy est de retour au collège de Saint-Césaire où la rentrée s’annonce.
Année scolaire 1904-1905
Le religieux ne consacre que quelques pages à cette année scolaire. Cependant, ses notes permettent de prendre la mesure de son organisation, des événements – religieux ou non – qui la rythment et, plus généralement, de la vie quotidienne au collège de Saint-Césaire.
Mercredi 7 septembre 1904
Rentrée des élèves. Chants. Cris de joie. Musique. Arrivée des élèves des États-Unis. Chaque élève du village apporte son lit, sa valise, fait son installation lui-même.
Mercredi 13 septembre
Messe du Saint-Esprit à l’église paroissiale. Sermon par le R. P. Léonard […].
Mercredi 21 septembre
Triduum préparant au jubilé du Cinquantenaire de l’Immaculée-Conception.
Retraite au collège.
Un peu de neige […].
Mardi 11 octobre
Les musiciens de la Garde républicaine de France passent un mois à l’exposition universelle de Saint-Louis, U.S.A, et viennent à Montréal donner un concert.
Dimanche 20 novembre
Expérience de sauvetage en cas d’incendie […].
Mardi 22 novembre
Fête de Sainte-Cécile. Congé.
Vendredi 25 novembre
Neige pour tout de bon.
Lundi 28 novembre
Fête du R. P. Léonard.
Discours, souhaits de fête.
Musique. Déclamations.
Messieurs les curés de Saint-Césaire, de Saint-Aimé, de Rougemont […].
2 janvier 1905
Les frères Léonide, Raphaël, Paul, Alexandre du collège de Sorel viennent à Saint-Césaire. Le 3 janvier nous allons au collège de Farnham. Froid vif.
14, 15 et 16 janvier
Quarante Heures. Chapelle du collège.

Figure 13Chapelle du collège de Saint-Césaire, Québec, vers 1910
Musée McCord, MP-0000.1028.7.
Mardi 17 janvier
Visite officielle du R. P. Provincial […].
Le R. P. annonce le changement probable du R. P. Léonard, souffrant. Besoin absolu de repos.
Mardi 31 janvier
Compte rendu du premier examen semestriel.
Lundi 6 et mardi 7 mars
Bazar de charité.
Très beau temps. Affluence.
Samedi 18 mars
Dégel et pluie.
Mercredi 29 mars.
Chaleur: 20 degrés.
Les érables commencent à couler.
Jeudi 30 mars
L’Yamaska, libre de glace.
Inondation à Saint-Pie. Rien à Saint-Césaire.
Lundi 3 avril
Cour libre. Jeux de balle sur la pelouse.
Jeudi 13 avril
Belle partie de sucre à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville […]. Temps superbe. Dîner sous les arbres. Promenade au bas de la montagne. Goûter au sucre. Dans la cabane, cuisson du sirop. Palettes en bois. Trempettes. 23 invités.
Semaine sainte: offices complets.
Dimanche 23 avril
Fête de Pâques. Très beau temps.
Lundi 24 avril
Grande séance publique. Pièce parfaitement réussie. Renégat et Martyr29.
12 et 13 mai
Je fais la retraite aux enfants de la première communion.
Dimanche 14 mai
Cérémonie de la première communion. Prédication du R. P. Lepage, venu de Saint-Laurent.
Semaine du 14 au 21 mai
Semaine très froide. Calorifère allumé.
Jeudi 25 mai
Pique-nique de la fanfare et de la chorale […].
Vendredi 16 juin
Pèlerinage des jeunes filles du couvent dans notre chapelle du Sacré-Cœur.
Lundi 19 juin
La fanfare du collège est demandée à Saint-Hyacinthe. Procession de la Saint-Jean-Baptiste. Un bateau à vapeur vient les chercher à 4 heures.
Mardi 20 juin
8 heures ½. Distribution des prix. Fanfare, orchestre, déclamations. Discours d’adieu des élèves diplômés.
À 2 heures, salut du Très Saint Sacrement.
3 heures. Musique dans le parc.
4 heures ½. Départ d’un train spécial qui conduit les élèves aux États-Unis […].
Dimanche 25 juin
Solennité de la Fête-Dieu
3 heures. Vêpres. Procession. Jeunes filles en blanc. Les femmes sur deux rangs. Société de Saint-Joseph. Musique. Fanfare improvisée. Enfant de chœur […]. Derrière le dais, la foule des hommes. Reposoir dans le cimetière (t. 1: 91-101).
Été 1905
Après le départ des pensionnaires à la fin de juin 1905, il demeure au collège jusqu’au 10 août suivant, date à laquelle il prend la route de Montréal. Comme l’année précédente, il se rend au noviciat de Sainte-Geneviève pour une retraite d’une semaine. Du 21 au 24 août, il visite de nouveau Montréal avant d’entreprendre une excursion chez les Iroquois de Caughnawaga
(Kahnawake)30 au sud de l’île de Montréal.
Vendredi 25 août 1905
Depuis mon arrivée au Canada, je caressais le projet de faire une excursion dans une tribu indienne. Je voulais voir les descendants des premiers habitants du Nouveau Monde.
Avec mon cher confrère de Neuilly, le frère Marie-Antoine31, nous partons pour Montréal et Lachine (t. 1: 106).
Sur le traversier, les deux Français rencontrent le père Arthur Melançon32, le prêtre jésuite responsable de la mission au sein de la réserve. Ce dernier devient leur guide.

Figure 14Vue de Caughnawaga (Kahnawake) depuis le Saint-Laurent, vers 1885
Musée McCord, VIEW-2471.
Le bon curé nous conduit à son presbytère. Logis antique, mais confortable, admirablement situé sur le bord du Saint-Laurent où passent steamers, steamboats, bateaux électriques, à gazoline, à voile, radeaux immenses de bois à bûcher, de bois à construction qui descendent des forêts avoisinant les Grands Lacs des États-Unis.
Nous visitons d’abord l’église dédiée à St-François-Xavier, puis le cher Père nous montre les objets précieux qui comportent le trésor religieux des Iroquois: un autel sculpté donné par Louis XIV; des calices; des baisers-de-paix33 vieux style; un ostensoir antique de 1668, ses sauvages n’en veulent pas d’autres pour les bénir; la bannière de la Sainte-Famille, l’autre encore plus remarquable de la Société de Saint-Jean-Baptiste fondée en 184134. Les inscriptions y sont en français et en iroquois.
Dans une boîte, à travers une vitre scellée, notre aimable curé nous fait voir les ossements d’une jeune vierge iroquoise Catherine Tegakouita35 […]. On lui attribue plusieurs miracles […].
Enfin, avec mille précautions, le R. P. Melançon déroule devant nous la ceinture de la paix. Cette ceinture est merveilleusement tissée avec de petits coquillages très rares, taillés en perles fines (t. 1: 108-110).
Leroy découvre que d’autres visiteurs français les ont précédés.
Dans le bureau du R. P. Melançon, je remarque un beau cadre renfermant un superbe portrait de Botrel et de sa dame36. Le célèbre barde breton est venu au Canada en 190237 et il a chanté devant les Iroquois […]. La photographie porte les deux signatures des visiteurs avec cette dédicace:
Au cher curé de Caughnawaga et à ses braves et accueillants paroissiens(t. 1: 112).

Figure 15Botrel au Canada. Monsieur et madame Botrel chez les derniers Peaux-Rouges
, 1903
Musée de Bretagne, 996.0024.7.
Leroy et son compagnon soupent avec les pères et les frères jésuites qui les hébergent pour la nuit. Le lendemain, les religieux assistent à la messe.
Samedi 26 août 1905
Les Iroquoises, avec leur habit noir et leur châle par-dessus la tête, ressemblent à des religieuses. Elles prient à haute voix. Les offices sont très suivis le dimanche. Le prêtre chante la langue liturgique, les sauvages répondent en iroquois. Ce sont les plus anciens qui tiennent à servir la messe (t. 1: 115-116).
Puis, comme de nombreux touristes avant eux, les Français déambulent dans la réserve et observent la vie de ses habitants (Simard, 1987: 150-152).
Pour prouver aux Blancs leur indépendance, les Indiens bâtissent parfois leur habitation au milieu d’une rue, ou de manière à fermer une avenue. C’est ce que nous avons vu en parcourant le village […].
Les Indiens ne veulent pas qu’un Blanc construise une habitation sur leur territoire. Ces enfants des bois ont été tellement pourchassés par leurs vainqueurs qu’ils se défient toujours […].
Les Indiens n’aiment pas la culture des champs et, comme ils sont d’habiles ouvriers, on les emploie dans les usines à Lachine. Les sauvagesses confectionnent des ouvrages en osier, en écorce, en paille, qu’elles vont vendre à Montréal […].
Une institutrice anglaise fait la classe aux petits Indiens qui jouissent du repos des vacances. Ils en profitent pour courir, folâtrer sur les rives de leur beau fleuve (t. 1: 117-121).
Le soir même, les visiteurs prennent congé de leur hôte et rallient le collège de Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, avant de prendre la route de Saint-Césaire le lundi 28 août. Lors du trajet en train, Leroy prend conscience que, deux ans plus tôt, il arrivait au Canada.
Chemin de l’exil, c’est un mot que comprend seulement celui qui s’y trouve. C’est un mot bien dur, mais que nos bons Canadiens ont su adoucir par leur cordiale réception, leur charité, leur sympathie, leur amitié […] (t. 1: 127).
Année scolaire 1905-1906
Le vendredi 3 novembre, Leroy reçoit une nouvelle importante.
Le […] premier assistant du T. R. P. Général38 m’envoie de France la circulaire numéro 38, datée d’Angers, 15 octobre 1905, et nommant les vingt religieux qui composent le Chapitre Général39 de 1906.
Ce chapitre doit se réunir le 8 août 1906 à l’Université de Notre-Dame (Indiana)40. Mes supérieurs du Canada m’ont nommé pour les délégués de cette province.
Je n’ai aucun mérite personnel pour cette haute et si noble fonction, si ce n’est un profond amour pour notre petite congrégation de Sainte-Croix […] (t. 1: 135-136).
Le début de l’année 1906 est marqué par la visite du supérieur général de la communauté, le père Gilbert Français, qui se rend dans les établissements de la province. Depuis Saint-Césaire, le convoi prend la direction de Sorel. Leroy l’accompagne.
Vendredi 9 février
Tous les élèves, avec leur fanfare, nous accompagnent à la gare. En attendant le train, les musiciens jouent plusieurs morceaux dans la salle d’attente.
Lorsque le Supérieur général monte en wagon, le chauffeur de la locomotive donne les coups de sifflet réservés aux grands dignitaires. La fanfare joue son morceau d’adieu dont l’harmonie échappe à nos oreilles; nous sommes déjà au milieu de la campagne […].
Sur les quais de la gare, sur un espace interminable sont rangés les 550 élèves du collège, tous poudrés de neige, […], la neige tombait à gros flocons […].
Le T. R. P. s’avance et la fanfare du collège le salue par ses notes les plus entraînantes. Ce morceau de musique a le don de faire cesser la neige.
Nous montons dans le traîneau présidentiel et l’immense cortège parcourt les principales rues de la ville. Sur les galeries des maisons, nous voyons quelques bonnes Canadiennes se mettre à genoux et faire le signe de la croix! Elles pensent sans doute qu’un Supérieur général est comme un évêque!
En arrivant au collège, nous passons au milieu de l’important défilé de tous ces enfants rangés sur deux lignes […].
Discours, fanfare, chant, orchestre. Rien ne manque à cette fête joyeuse. Si, quelqu’un manque… le p’tit père Combes41 qui aurait vu comment les Canadiens reçoivent les religieux qu’il a chassés si brutalement, avec une si criante injustice, de leurs maisons, de leur patrie! (t. 1: 160-162).
Français et Leroy se connaissent depuis longtemps et profitent de l’occasion pour évoquer leur passé commun à bord du train qui les mène à Sorel.
Nous causons du bon vieux temps, des événements qui ont bouleversé notre chère France, nous parlons de notre âge d’or à Neuilly, de nos amis […]. Il me semble que je suis en France, j’ai retrouvé ma patrie. Hélas, un coup d’œil par les larges et spacieuses fenêtres du wagon me ramène au Canada, l’immense capuchon blanc recouvre toute la nature (t. 1: 166).
Le 19 février, Gilbert Français quitte Saint-Césaire pour se rendre à Montréal où aura lieu le 15 mars l’assemblée générale du Chapitre provincial auquel participent tous les supérieurs du Canada. Le supérieur général prend ensuite la route des États-Unis.
La vie au collège reprend son cours normal. Seule l’actualité internationale retient l’attention de Leroy.
Mercredi 18 avril 1906
Les journaux nous font connaître la terrible secousse du tremblement de terre qui a détruit la ville de San Francisco, Californie […]. Incendie général d’une grande partie de la ville42.
Ce mois-ci, deux autres désastres avaient eu lieu:
Courrières43, France, Pas-de-Calais: 1200 mineurs tués ou brûlés dans les galeries souterraines […]. Vingt jours après, on retrouvait 14 mineurs vivants.
Italie. Formidable éruption du Vésuve détruisant toutes les villes situées au bas ou à mi-côte de la montagne, et menaçant Naples44. Souvenir de ma visite au Vésuve en 1887 (t. 2: 193-194).
Au mois de mai, c’est l’actualité politique française qui le désespère.
Lundi 7 mai 1906
Les journaux donnent un aperçu des élections d’hier45. Le résultat est encore favorable au gouvernement. Mon Dieu, protégez la Sainte Église contre ses ennemis, ayez pitié de la France!
La France comprend-elle qu’elle a péché, qu’elle a laissé commettre des injustices envers ceux qui la servaient sous l’œil de Dieu, en instruisant les jeunes Français fréquentant les collèges et les écoles que les religieux et les religieuses dirigeaient avec tant de succès? Le crime attire le châtiment… (t. 2: 212-213).
Comme chaque année, le mois de juin est consacré à la cérémonie de distribution des prix aux élèves, avant que ces derniers quittent le collège pour l’été.
Mardi 19 juin 1906
Les familles de Saint-Césaire et des environs assistent en grand nombre à cette distribution des prix […] au collège. Moment toujours solennel et impressionnant pour les élèves qui attendent le couronnement de leurs efforts pendant l’année scolaire […].
Allez maintenant dans vos familles, jeunes amis, soyez des fils respectueux, une aide pour vos parents, une édification pour ceux au milieu desquels vous vivrez (t. 2: 253-256).
Voyage aux États-Unis (30 juillet-4 septembre 1906)
Vers l’Université Notre-Dame-du-Lac, Indiana
Le 16 juillet, Leroy fait partie du groupe de religieux qui accueille la délégation française à Montréal46.
Le chef de douane avec lequel nous avions parlé sur les quais, voyant notre grand désir de sauter au cou de nos chers voyageurs, nous fait un signe gracieux pour nous permettre d’entrer sous le hall. Nous l’en remercions sincèrement.
Quels moments d’une douce émotion en embrassant nos chers confrères de France. […].
J’ai souvent correspondu avec nos vénérables assistants47. Une lettre, c’est une partie de nous-même qui retourne au pays natal, c’est vrai; mais revoir mes confrères de Neuilly avec lesquels j’ai vécu une trentaine d’années, quel bonheur, quelle joie! Et comme les souvenirs des années passées reviennent en foule à la mémoire! (t. 2: 285-287).
Les nouveaux arrivants séjournent au collège Notre-Dame-des-Neiges, puis à Saint-Césaire à partir du 21 juillet. Les jours suivants sont consacrés à la visite des établissements de la congrégation.
Le 30 juillet 1906, les délégations du Canada et de la France quittent Montréal en empruntant un train du Grand Tronc en direction de South Bend, en Indiana.
La voie suit le fleuve Saint-Laurent, rive gauche, et notre long convoi semble glisser sur les rails plutôt que rouler tant les secousses sont peu sensibles et le bruit presque inconnu […].
Le premier arrêt se fait à Cornwall. On aperçoit le canal qui évite aux bateaux le passage dans le Saint-Laurent où les rapides, à cet endroit, forment un véritable obstacle.
Prescott où nous arrivons vers 11 heures et quart […].
Nous remarquons à notre droite de belles vignes, bien cultivées, ce qui nous fait penser aux produits si riches de notre Bourgogne, de la Champagne et des environs de Bordeaux […].
Nous traversons un endroit admirable. Une multitude incalculable d’îles disséminées dans le fleuve nous montre, les unes un château fort flanqué de hautes tourelles environné de bosquets charmants; dans une autre, des chalets de toutes formes […].
Le train s’arrête. Nous touchons presque un des îlots enchanteurs, et sur la station nous lisons Thousand Islands. C’est bien cela, Mille Îles, dont j’avais entendu parler par un père d’un de mes élèves de Neuilly qui, souvent, m’avait vanté les beautés du Canada.
Nous aurions voulu rester plus longtemps à contempler ce beau panorama, mais le convoi nous emporte rapidement et nous amène à Kingston […].
Une grande et belle cité se dessine dans le lointain, de hauts clochers dominent le paysage. C’est Toronto […]. Depuis longtemps ce nom de Toronto m’est connu. Je me souviens d’avoir vu à Sainte-Croix du Mans Mgr Armand de Charbonnel48 qui fut évêque de cette ville […].
Hamilton […]. En se dirigeant vers l’Ouest, la contrée devient plus pittoresque et le soleil, sur le déclin, se cache derrière les collines boisées qui environnent London où nous arrivons. Belle ville moderne et de genre américain.
Windsor […] est la dernière cité canadienne, je crois, elle est située en face de la capitale du Michigan, Détroit49 (t. 2: 314-322).
Le lendemain, le 31 juillet, après une nuit passée à bord du train, dans leur wagon Pullman converti en voiture-lit, les religieux français découvrent enfin South Bend.
Nous apercevons sur les quais de la gare […] le F. Joseph, notre ancien préfet de discipline de Neuilly, […] accompagné de deux frères américains […] que nous avons l’occasion de connaître et d’apprécier. Deux voitures nous reçoivent et nous conduisent en vingt minutes à l’Université de Notre-Dame, dont, bientôt, d’une des belles rues de la ville, nous découvrons le dôme doré qui apparaît majestueusement au-dessus des grands arbres […] (t. 2: 327-328).
Augustin Leroy est très impressionné par les lieux.
Par les gravures que je connaissais depuis longtemps, j’étais familiarisé avec le panorama que présente Notre-Dame, mais la réalité a dépassé mon attente.
L’aspect de tous les monuments qui composent cette grande université est des plus gracieux et des plus agréables à contempler. De tous les côtés surgissent de véritables palais au milieu des parterres, des pelouses, des bosquets, des massifs fleuris, des parcs, des prairies et […] deux lacs ravissants de fraîcheur et de gentillesse (t. 2: 328-329).

Figure 16Université Notre-Dame-du-Lac, comté St-Joseph en Indiana (É.-U.), en 1844
Library of Congress, LC-DIG-pga-04632.
Les voyageurs sont accueillis par le père Gilbert Français.
Le T. R. Père nous conduit à notre nouvelle demeure, à Sorin Hall, bâtiment à quatre tourelles, tout près de l’église. C’est là que se tiendront les séances du chapitre général et tous les capitulants devront y loger (t. 2: 329-330).
À 6 h, la célébration de la messe permet aux religieux de découvrir l’église.
L’église, qui ressemble à une cathédrale, est de toute beauté, style gothique, avec de superbes vitraux sortant des ateliers des Sœurs carmélites du Mans […] (t. 2: 331).
À 7 h, ils se rassemblent pour le déjeuner.
Le F. Joseph a eu la délicate idée de nous faire prendre notre premier repas à une table spéciale qui réunit tous les frères de France. Nous étions neuf50 […]. Agapes fraternelles et bien joyeuses, je vous assure. Nos confrères américains ont dû nous trouver expansifs et grands parleurs; mais comment nous taire au souvenir de notre chère patrie dont nous pouvions nous entretenir ensemble? (t. 2: 332-333).
Le reste de la journée est consacré à la découverte des lieux.
Il faut vivre ici pendant trois ou quatre mois pour comprendre la vie intense qui règne dans ce collège unique en son genre. Il faut y vivre surtout pendant l’année scolaire, alors que les 700 élèves animent de leur bruyante présence les pelouses et les parcs, et quand tous les bâtiments les reçoivent pour y suivre les cours de sciences et le droit, les arts, les lettres, et tout un arsenal d’autres choses […].
Nous arrivons au bout de la grande allée qui conduit à South Bend. C’est là qu’une statue en bronze du T. R. P. Sorin51 a été érigée dans le courant de cette présente année 1906. Socle en granit d’un très beau modèle sur lequel on a gravé en relief ce seul mot:
Sorin[…].À droite de cette statue, si l’on regarde les bâtiments, on voit le Post Office de Notre-Dame tenu par trois religieux qui ne manquent pas d’ouvrage […]. Le vis-à-vis du bureau de poste est la porterie, la demeure du concierge. Ce nom est sans aucune attribution; dans un pays libre comme l’Amérique, les entrées sont toujours ouvertes, il n’y a pas ou peu de barrières […].
Voici à droite, un peu en arrière du Post Office, l’observatoire avec sa coupole mobile pourvue d’un équatorial et d’un télescope qui permettent de se promener avec les étoiles […].
Viennent ensuite les différents laboratoires de physique de chimie, de bactériologie, avec tous les accessoires les plus perfectionnés […].
Le
Palais des sciencesrenferme les musées de zoologie, des fossiles, de la minéralogie, de la botanique, de la numismatique, etc.Des appartements spéciaux contiennent tout ce qui a rapport au dessin […]. C’est là que se trouvent les appareils électriques démontés pour en faire comprendre le mécanisme: télégraphes, téléphones, photographie, etc.
Washington Hall, avec sa haute tour en forme de clocher, contient un vaste théâtre de 1 200 places. C’est aussi le département de musique.Un peu à droite du grand dôme, on admire au milieu d’un gracieux parterre
St Edward’s Hall, collège pour les plus jeunes enfants que le T. R. P. appelaitses petits princes[…]. Ce petit collège est entièrement sous la direction des Sœurs de Sainte-Croix pour les études et les classes […].Nous voyons
Saint-Joseph’s Industrial School. Ce bâtiment est spécialement réservé aux jeunes étudiants qui, ne pouvant payer le prix intégral de la pension (400 dollars et plus), servent leurs camarades au réfectoire et, tout en suivant les cours d’études, s’exercent à un métier quelconque sous la direction des frères coadjuteurs52.
Sorin Hall[…] contient 101 chambres pour les étudiants de deuxième année. Il y a chapelle, bibliothèque, salle de lecture et, dans le sous-sol, salle de récréation, salle de bains, etc. Un téléphone relie entre eux tous les nombreux bâtiments qui composent l’université de Notre-Dame et un second téléphone est réservé pour le dehors et les grandes distances.Ce bâtiment entre les deux lacs est
Community House. Maison professe et en même temps maison de retraite pour les religieux prêtres et frères âgés ou infirmes qui attendent dans le recueillement et la prière que Dieu les appelle […].Au bout du lac Sainte-Marie, à gauche:
Holy Cross Seminary. Charmante résidence de 102 jeunes gens qui, tout en suivant les divers cours de l’université, se disposent à entrer dans notre congrégation […]53.Le Séminaire, tout près du lac Sainte-Marie, […] est une agréable habitation. Nous l’avons visité avec plaisir; nous avions parmi les étudiants plusieurs jeunes compatriotes qui avaient été obligés, comme tant d’autres, de quitter leur pays natal en 1903 […].
À une faible distance du Séminaire […], nous entrons dans le cimetière de la communauté. Vaste champ des morts qui contraste grandement avec les splendides jardins de l’université. Ici, pas une fleur! […].
Au cimetière, Leroy repère les tombes de trois pères et quatre frères qu’il a connus en France, dont Pierre Véniard qui, avant de rejoindre l’Indiana en 1877, a œuvré au Canada en tant que vicaire, puis curé de la paroisse Saint-Laurent54. Après ce moment de recueillement, la visite continue.
Après avoir quitté le sentier du lac, on trouve une voie ferrée établie pour le transport du charbon, car nous arrivons au bâtiment des machines. Cette gigantesque cheminée, qui domine tout le paysage, sert de foyer à dix chaudières presque toujours en ébullition […]. Cinq ou six chaudières sont allumées et donnent […] partout l’eau froide, l’eau chaude, l’eau potable, aux appareils de la boulangerie, de la buanderie, de l’imprimerie, etc.
Tout près de la boulangerie, nous visitons la grande piscine pour la natation, même pendant l’hiver, car l’eau est chauffée […].
Puisque nous sommes de ce côté, jetons un coup d’œil sur le salon du coiffeur, du barbier et, tout près, également, pénétrons discrètement dans la grande boutique où un frère vend un assortiment d’objets de piété, de bonbons, de cigares, etc.
(t. 2: 333-368).
La visite se poursuit le lendemain.
Mercredi 1er août, Université de Notre-Dame
Nous recommençons nos courses dans l’immense propriété, et nous visitons tout d’abord l’université […].
Au milieu du vestibule formant une large croix grecque s’élève la rotonde qui supporte le dôme. Des bustes en marbre blanc ornent la grande allée du milieu. De superbes peintures murales […] représentent, en grandeur naturelle, Christophe Colomb et sa merveilleuse découverte du continent américain […].
Partout dans les espaces laissés libres […] on a placé: portraits, cadres, autographes de personnages illustres, dessins, cartes géographiques, plans de villes, photographies, paysages, etc. […].
Au premier étage, les appartements du R. P. Président de l’université et la bibliothèque, qui est beaucoup trop petite pour le nombre respectable des 5 500 volumes qu’elle renferme. Un peu partout dans cette bibliothèque sont disséminés des objets d’art, soit religieux, soit profanes, des reliquaires antiques, des souvenirs de tous les pays, des collections d’ouvrages faits par les Indiens […].
Nous avons hâte de visiter les dépendances de l’imprimerie, dont l’office de l’Ave Maria occupe une grande partie. Ce journal, ou plutôt cette livraison, fut fondé en 1865 par le T. R. P. Sorin […]. La machine rotative peut imprimer 25 000 exemplaires à l’heure. Cette petite Marinoni55 américaine, comme toutes ses semblables, prend la grande feuille, l’imprime des deux côtés, la coupe, la plie. Une autre machine reçoit les paquets et les transporte dans l’appartement réservé aux Sœurs de Sainte-Croix. Ce sont les sœurs qui remplissent les composteurs de ces milliers et milliers de lettres nécessaires à l’impression d’un volume […].
Il y a 143 sœurs employées pour le service de l’Université, sans compter les jeunes servantes ni les domestiques […]. La cuisine est en rapport avec le personnel de Notre-Dame. C’est vous dire que les fourneaux à vapeur, les chaudières, les rôtissoires et autres ustensiles sont d’une dimension à faire reculer d’épouvante une ménagère de mon village qui se croirait perdue au milieu de tout cet attirail culinaire destiné à préparer la nourriture d’un véritable régiment […].
Nous n’avons pas encore visité une partie très intéressante de Notre-Dame: l’endroit des bâtiments primitifs élevés par le T. R. P. Sorin en 1842. Nous y allons en descendant à la grotte de Lourdes. Cette grotte de grandeur naturelle et sur le modèle de celle des roches massabielles56 est devant une esplanade baignée par le lac Sainte-Marie […].
Sur le bord du lac Sainte-Marie que nous longeons ensuite, apercevez-vous une statue de saint Joseph? C’est là que le T. R. P. Sorin et les six frères de Sainte-Croix furent reçus par les Indiens à leur arrivée sur cette terre américaine le 6 novembre 1842. La petite chapelle, en bois non travaillé, est en tout semblable à celle que le T. R. P. Sorin construisit à cette époque […].
La ferme de Notre-Dame et ses dépendances sont installées non loin des ateliers. Nous passons rapidement au milieu des différents bâtiments qui composent cette ferme, mais nous ne pouvons nous empêcher d’admirer la belle écurie qui contient 40 chevaux (t. 2: 369-383).
La découverte du site est aussi l’occasion pour Leroy de retrouver de vieilles connaissances.
Malgré la chaleur torride, nous avons hâte de faire une visite à St. Mary’s Academy57, maison des Sœurs de Sainte-Croix dont la superbe propriété fait suite à celle de Notre-Dame. J’avais à voir une religieuse française, S. Marie-Eugénie, autrefois élève chez les Dames Augustines de Neuilly, pendant que son frère Dorbesson étudiait dans notre collège de Sainte-Croix […].
Sur les marches du perron, en avant du portique d’entrée, nous trouvons S. Marie-Eugénie qui nous attendait. Ses yeux vifs et pénétrants, non, plutôt son cœur français et aimant nous avait devancés.
Les salutations de part et d’autre sont chaleureuses et cordiales, les interrogations sont multiples et les réponses s’entremêlent avec les questions. C’est compréhensible, nous avions tant de choses à nous dire […].
Nous ne restons pas longtemps, nous suivons la S. Marie-Eugénie qui nous entraîne, c’est le mot, du côté de la demeure des Chapelains de St. Mary. Pourquoi cette précipitation? J’en cherchais la cause lorsque, sur le seuil de la porte, je me trouve en face du R. P. Augustin Goupille…
Un jet de larmes monte à mes yeux en embrassant mon ancien et très aimé supérieur de Sainte-Croix de Neuilly! Émotion sensible, oui, mais émotion bien douce! On avait sangloté en se quittant le 28 juin 1903, au moment où une loi injuste et cruelle nous chassait de notre collège, et trois ans après on pleure en se revoyant sur une terre libre et hospitalière, mais qui n’en est pas moins une terre d’exil! (t. 2: 383-388).
Les deux hommes correspondaient régulièrement depuis 1903 pour partager leurs expériences de part et d’autre de la frontière canado-américaine (ACSC-Montréal, PQ1.230).
Plus tard dans la journée, Leroy accompagne un de ses hôtes lors d’un bref aller-retour à South Bend.
South Bend est une cité vaste, propre, avec des rues pavées comme Montréal devrait en avoir. Les avenues larges, bordées d’arbres et de gazon, possèdent de belles résidences entourées de pelouses et de jardins soignés.
Les 9 paroisses catholiques sont desservies par des pères de Sainte-Croix. Nous entrons dans une de ces églises, nous la trouvons remplie d’une pieuse foule […].
Un pont vient d’être refait sur la belle rivière Saint-Joseph qui traverse la ville. Un jardin public, nouvellement installé, possède de vastes pelouses où les grands peuvent se déployer. Les élèves de l’Université viennent parfois s’y mesurer avec d’autres clubs étrangers à la localité […].
Le commerce est très actif à South Bend. La compagnie des machines à coudre Singer y possède une immense manufacture, et une compagnie plus prospère encore, celle des voitures, emploie un nombre considérable d’ouvriers58 (t. 2: 393-396).
Ces deux jours consacrés à la découverte de l’université américaine suscitent une forme de frustration chez Leroy, qui ne peut s’empêcher d’évoquer la situation politique en France dans l’un de ses carnets de notes.
L’université de Notre-Dame, Indiana, fait comprendre ce que les religieux peuvent faire dans un pays libre. Si la France avait compris son intérêt intellectuel, moral et même matériel, elle aurait laissé les religieux élever des collèges, des écoles, des orphelinats partout; et, en ce moment, notre patrie, au lieu de faire hausser les épaules aux autres peuples, les égalerait tous par son savoir et la vaillance chrétienne de sa jeunesse (t. II: 97).
Excursion à Chicago (2-5 août 1906)
Du 2 au 5 août, Leroy fait partie d’un groupe de religieux qui séjourne à Chicago, dans l’État voisin de l’Illinois, où la congrégation dessert la paroisse polonaise Sainte-Trinité depuis 1893 (Dolan, 1985: 183).
Sur place, il retrouve Marc Guérin, un ancien élève du collège de Neuilly entre 1893 et 1898, qui se propose de faire visiter la ville aux religieux.
Vendredi 3 août 1906
Nous sortons dans l’avenue et, de suite, nous prenons place dans le chemin de fer suburbain qui circule tout le long du lac. Un beau spectacle nous est donné. Des embarcations de toutes sortes sillonnent ce lac […].
Nous descendons à une station éloignée; nous y trouvons une voiture à deux chevaux de belle allure […].
Nous passons par des avenues larges, parfaitement entretenues et ayant de chaque côté de somptueuses habitations, comme la demeure princière de Messieurs Rockefeller, Pullman et autres milliardaires. Nous ne sommes pas au centre des affaires, pas de magasins, pas de réclames, […], pas de bruit, un mouvement modéré, tout cela indique une partie de la ville habitée par les personnes aisées, par l’aristocratie ou par les riches familles commerçantes dont le magasin est au loin […].
Une belle rangée d’arbres se présente à nous […], nous entrons dans le magnifique parc du sud, le Washington Park. Nous autres Français qui habitons un petit bijou de pays, nous n’avons pas d’idée sur la grandeur de ces parcs qui font partie de la ville américaine. Nous suivons une allée qui longe le lac Michigan. Ce lac forme une ceinture d’azur à Chicago et donne à cette partie de la ville un aspect réellement admirable […].
En parcourant les différents quartiers de cette immense ville, nous descendons dans je ne sais quelle street pour rendre visite au maître de ce monde […].
Voici le Post-Office, la bibliothèque, le fameux bloc où se réunissent les francs-maçons. Hélas, ici comme partout, cette association domine sur la contrée.
Le métro continue sa course vertigineuse pendant que nous descendons à une station située dans le centre du commerce […]. Ce n’est plus cette tranquillité des quartiers fortunés, c’est une cohue de voitures, de camions, c’est le va-et-vient d’une foule de gens d’affaires qui se croisent, se heurtent et semblent toujours en retard (t. 3: 493-509).
Après une nuit passée au presbytère de la paroisse Sainte-Trinité, les Français effectuent une nouvelle excursion.
Samedi 4 août 1906
Après avoir assisté à la messe de 7 heures, nous sommes prêts à partir. Nous devons visiter les fameux abattoirs dont on a tant parlé […].
La grande ville du commerce s’éveille de bon matin, et de partout le mouvement se dessine aussi intense que celui d’hier au soir […].
Après avoir traversé des avenues bordées de charmantes villas, des quartiers populeux où la richesse ne semble pas résider, nous voici en face d’un grand portique en bois, surmonté d’une gigantesque paire de cornes; c’est l’entrée des Stock Yards ou parcs à bestiaux.
Nous avançons dans une longue et large avenue où tout un monde affairé de commissionnaires, de courtiers, d’ouvriers, de conducteurs de bestiaux à pied ou à cheval s’y presse au bruit plus ou moins harmonieux des mugissements des animaux et du grognement des porcs qui sont logés en plein air ou sous des toitures en bois. Tout cela forme un immense damier s’étendant à perte de vue. Une petite ville de maisonnettes en bois s’élève à côté où logent les employés, les ouvriers, avec une petite église et même un journal spécial Chicago Sun. Plus loin, ce sont les chemins de fer qui font le service dans tout cet amas de maisons, de docks, de remises, de magasins, etc.
Nous nous présentons à l’entrée de grands bâtiments dont l’élégance est un peu douteuse. C’est là que s’opère le Pork Packing, c’est-à-dire le massacre et la préparation des 1 700 000 porcs que Chicago fournit annuellement aux amateurs de charcuterie des deux mondes (t. 3: 509-512).
La visite se poursuit à l’intérieur de l’abattoir où Leroy peut observer les ouvriers au travail.
Chaque ouvrier ne fait qu’une chose, toujours la même, frappe au même endroit, sépare la même pièce, enlève le même morceau. Tout cela est fait avec une vitesse extraordinaire. Dans une heure, mille porcs subissent cette transformation. Les dépouilles sont jetées dans des chaudières à suif. Plus loin, la fabrique de savons. Rien n’est perdu […].
Dans cette autre grande salle, les boîtes de conserve sont peintes et vernies par de jeunes filles qui doivent tenir leur langue en cage […].
Nous voici dehors. Les ouvriers quittent leurs travaux, les magasins se ferment, des voitures de l’administration viennent prendre les ouvrières pour les conduire dans le centre de leurs quartiers (t. 3: 514-518).

Figure 17Le parc White City de Chicago, vers 1905 (détail)
International Stereograph Co, Library of Congress, 90713710.
L’après-midi est consacré à la découverte du parc zoologique, de l’aquarium et de plusieurs parcs. Après un bref passage au presbytère pour le souper, les Français rejoignent White City, un parc de loisirs ouvert l’année précédente.
[…] après avoir traversé rues, places, avenues, nous arrivons en face d’un portique brillamment illuminé, et en lettres de feu, nous lisons sur le frontispice: White City.
Dénomination bien méritée, car c’est un éblouissement qui me rappelle les fêtes de nuit aux expositions universelles de Paris! […].
D’innombrables lampes électriques dessinent les monuments, les arcades, les jardins, les exhibitions de toutes sortes. Réunion extraordinaire de tout ce qui peut intéresser, amuser, petits et grands.
On y voit: les catacombes, le travail des mineurs, celui des pompiers, des cirques, le toboggan nautique, les dompteurs d’animaux féroces, les grandes roues, le Vésuve en éruption, des panoramas, des fontaines lumineuses, la vue de Venise en gondole et Chicago par le feu.
Cette dernière attraction nous tente et nous suivons la foule qui pénètre dans Chicago Fire. Sur la scène est représentée la ville de Chicago. Un monsieur montre les différents quartiers qui composaient la cité à cette époque et détermine la place où cette conflagration épouvantable a commencé […]. La nuit règne dans le théâtre et devant soi, la ville […].
Bientôt les flammes envahissent tout, les maisons s’écroulent, les détonations se font entendre. Chicago n’est plus qu’un immense brasier au milieu d’une fumée qui s’avance devant les spectateurs. La toile tombe, le rideau s’abaisse et le tableau va recommencer pour ceux qui attendent (t. 3: 526-529).
Le lendemain, 5 août, les voyageurs prennent le train qui les ramène à South Bend, avant de retrouver l’université en fin d’après-midi. Les deux jours suivants sont consacrés à des réunions préparatoires en vue de l’ouverture du Chapitre général, d’abord entre Français (6 août), puis entre Français et Canadiens (7 août).
Le Chapitre général (8-20 août 1906)
Le Chapitre général commence le mercredi 8 août.
À 6 heures du matin, le son majestueux du bourdon de Notre-Dame annonce l’ouverture officielle du Chapitre.
La messe capitulaire est chantée solennellement par le T. R. P. Français. Après cette messe, tous les religieux de l’université, au chant du Veni Creator, se rendent processionnellement à Sorin Hall, réservé pour la session du chapitre.
Le R. P. Linneborn59 fait la longue liste des religieux décédés depuis le dernier Chapitre général. Après les prières récitées pour les défunts, le promoteur fait l’appel des capitulants. À mesure qu’ils s’entendent appeler, ils prennent leurs places, et ceux qui ne sont pas capitulants se retirent (t. 3: 550-551).
La première séance est dédiée à la nomination par scrutin secret des six fonctionnaires nécessaires au bon fonctionnement du chapitre, à savoir un promoteur, deux scrutateurs, un père et un frère, un secrétaire de langue anglaise, un second de langue française et un portier. Augustin Leroy est élu au poste de secrétaire de langue française, une marque de reconnaissance pour le religieux dont les compétences en matière de rédaction sont appréciées.
La charge d’un secrétaire de Chapitre général n’est pas une sinécure […]. Dans les moments libres, en dehors des séances du Chapitre et des commissions60, je n’ai pas une minute à perdre […].
Dimanche 19 août 1906
Mon travail de secrétaire […] qui me donne un surcroît de besogne tous les jours, m’empêche d’assister à aucun autre office qu’une messe basse. Le Chapitre doit se terminer demain et toutes les écritures doivent être en règle (t. 3: 554-563).
Après une session de douze jours, le chapitre est clos le 20 août à la suite de l’élection d’un nouveau conseil à bulletin secret. Il s’agit de désigner les assistants généraux, le procureur général et les trois provinciaux.
Au sortir de la séance, le vote est aussitôt connu dans Notre-Dame et le téléphone annonce partout les nominations faites par le Chapitre […]. À 5 heures du soir, les capitulants généraux réunis devant le portique de Sorin Hall sont photographiés. Dans la salle des délibérations après une session de 12 jours, la 21e et dernière séance se termine par la lecture du long procès-verbal et des décrets du Chapitre à soumettre au Saint-Siège. La clôture de la session de 1906 est promulguée. À la chute du jour, tous les religieux de Notre-Dame se réunissent dans la crypte de l’église […]. Le bourdon de Notre-Dame sonne à toute volée dans sa demeure aérienne […]. Le ton solennel de cette grosse cloche se répercute dans le silence des bois et des bosquets; les échos lointains reproduisent les dernières vibrations de ce colosse de bronze (t. 3: 565-567).
Le lendemain, mardi 21 août, les Français se réunissent de manière informelle.
En ce moment, sous le ciel embrasé de l’Amérique du Nord, je bénis Dieu de me voir auprès du R. P. Goupille, ancien supérieur de Neuilly, du P. Labbé, ancien préfet des études, du F. Victorien, économe, du F. Cécilien, caissier, du F. Joseph, ancien préfet de discipline (t. 3: 574-575).
Les jours qui suivent sont consacrés surtout à de longues promenades, à de nouvelles visites et à l’organisation du voyage de retour.
Vendredi 24 août 1906
Avec le F. Joseph, je vais à South Bend à l’agence des transatlantiques pour acheter les billets de passage de nos quatre confrères devant s’embarquer à New York jeudi prochain: cabine de seconde classe, 50 $ - 250 F […].
Nous allons ensuite à la gare demander si mon billet de retour de Chicago à Montréal peut me servir en passant par les chutes du Niagara. Réponse affirmative. Je ne vous cache pas le plaisir que j’éprouve. Être au Canada, passer à quelques lieues du Niagara sans voir les chutes si renommées, c’est demander une forte dose de résignation à un amateur de la belle nature! (t. 3: 583-584).
Niagara Falls – New York – Philadelphie – Montréal (26 août-3 septembre 1906)
Le 26 août, Leroy quitte l’Indiana avec ses confrères de France qu’il doit conduire jusqu’à New York, leur port de départ. Ce voyage de retour est l’occasion pour les religieux de faire du tourisme.
Le lundi 27 août, ils font un arrêt à Niagara Falls pour admirer les fameuses chutes, un des sites touristiques les plus prisés du continent (Jasen, 1995).
J’ai devant moi ce merveilleux et incomparable spectacle que donnent au voyageur ébloui les célèbres chutes du Niagara! Dieu seul peut faire un ouvrage semblable et, du fond du cœur, on exalte sa puissance, on le prie, on tremble, tout en admirant cet imposant tableau […]. Le spectacle est sublime, mais il est effrayant (t. 3: 602).
Le soir, les religieux embarquent pour Buffalo pour un dernier arrêt, au cours de la nuit, avant de rallier New York le lendemain, mardi 28 août.
Plus de collines ni de montagnes, nous parcourons une contrée où les habitations sont près les unes des autres; les gares plus rapprochées, plus vastes. Les grandes cheminées des usines remplacent disgracieusement les grands arbres touffus de la forêt, à n’en plus douter nous approchons de New York […].
Nous voici à Newark, Jersey City, immenses villes industrielles et populeuses. Notre convoi circule plus lentement à travers d’interminables dépôts de marchandises de wagons, de locomotives, de docks […].
Enfin, nous pénétrons dans un hall gigantesque: c’est la gare de New York […].
La compagnie du chemin de fer transporte gratuitement ses voyageurs jusqu’aux quais de la ville où se trouvent ses bureaux pour les tickets de voyage et pour l’enregistrement des colis. Ces bateaux Ferry-Boat font constamment la traversée d’une rive à l’autre, et abordent à différents centres.
Ce qui me frappe, tout d’abord, c’est le va-et-vient incroyable des bateaux circulant de tous côtés; les uns vont au port, les autres en sortent, ceux-ci vont à droite, ceux-là manœuvrent à gauche; c’est un pêle-mêle animé vraiment curieux et qui ne manque pas d’originalité […].
Notre bateau, lui, nous conduit directement dans le quartier de notre hôtel […].
Le tramway qu’on nous a indiqué nous conduit devant l’hôtel Saint-Raphaël. Maison de modeste apparence où nous trouvons un prêtre comme propriétaire hôtelier et des sœurs allemandes pour le service intérieur […].
Une belle chapelle dans l’hôtel même permet aux prêtres de dire la Sainte Messe tous les matins et aux autres voyageurs d’y assister (t. 3: 620-626).
Bien installés, les Français profitent du reste de la journée pour déambuler dans la ville.
Sans nous en apercevoir, nous marchons dans une longue rue très animée et un peu plus large que les autres, c’est le Broadway […]. C’est une rue bordée de riches magasins, d’hôtels splendides, de résidences princières où logent quelques-uns de ces archimillionnaires qui ne se refusent rien, même pas d’accaparer le commerce entier d’une industrie quelconque, au grand détriment des plus humbles.
C’est là aussi que se voient ces bâtiments énormes en hauteur, ces blocs Building donnant le vertige quand on regarde le toit qui couronne le 32e ou le 34e étage! (t. 3: 628-629).
Le mercredi 29 août, ils continuent leur exploration. Comme bien d’autres visiteurs, Leroy est saisi par le mouvement permanent qui prédomine dans la ville américaine en plein essor et par l’activité qui y règne (Simard, 1987: 133-134; Balloud, 2019: 388-400).
Cet endroit est particulièrement intéressant par l’aspect des innombrables bateaux qui s’y meuvent sous tous les pavillons et dans tous les sens. New York est bien le vestibule mercantile des États-Unis.
Le métropolitain nous conduit ensuite à la 5e avenue. Nous y visitons la cathédrale catholique de St-Patrick, splendide église gothique en marbre blanc […].
Nous retrouvons notre Broadway de la veille et son mouvement encore plus accentué. Cet important édifice à hautes colonnes de marbre est le Stock Exchange, la banque de M. J. P. Morgan et Co. Combien de mortels, en passant devant ce temple de la monnaie, convoitent une part des dollars qui circulent là-dedans, croient-ils les douleurs, les ennuis, les tracas de cette opulente maison? […].
Nous voici au pont de Brooklyn […]. Brooklyn est la résidence d’un nombre considérable de personnes ayant leur magasin ou leur bureau à New York […].
Enfin, nous sommes au milieu du pont […]. Je tiens mon chapeau d’une main et le parapet du pont de l’autre, pour jouir du magnifique spectacle que présente New York avec son océan de toitures d’où surgissent çà et là comme une tour de Babel ces blocs démesurément hauts […] (t. 3: 632-642).
Après un nouveau trajet jusqu’à Central Park où ils passent un long moment, les religieux reviennent à leur hôtel. Le lendemain, jeudi 30 août, ils prennent la direction du port.
Le magnifique bateau La Savoie est amarré au quai, ses deux cheminées lancent une fumée épaisse qui papillonne au-dessus du hall où entrent les voitures chargées de valises, de caisses, de paquets, etc. […].
Nous faisons nos dernières recommandations à nos chers confrères qui vont retrouver nos amis de France […].
Dix heures. Un son de cloche, quelques brefs commandements, un coup de sifflet et le navire se met en marche (t. 3: 646-648).
Leroy accepte ensuite de suivre son dernier compagnon de voyage, le frère Joseph, qui souhaite se rendre à Philadelphie à l’invitation d’un ami, un certain Charles Heilman.
Superbe ville […], le bijou de l’Amérique du Nord, cité immense parce que chacun possède son home en briques rouges à deux étages avec perron en marbre blanc. Ville très propre, rues spacieuses, larges trottoirs […].
Nous sommes émerveillés en contemplant le superbe hôtel de ville dont la haute tour de 170 mètres est surmontée de la colossale statue de William Penn, fondateur de l’État.
Les magasins illuminés en ce moment sont moins réclames qu’à New York et à Chicago; il y a plus d’élégance, plus de goût dans la disposition des devantures. Philadelphie, sous ce rapport, se rapproche de Paris (t. 3: 653-655).
Les journées suivantes sont essentiellement dédiées à la visite de plusieurs lieux et monuments marquants de l’histoire américaine: City Hall, Independence Hall, Carpenters Hall, le Christ Church Burial Ground où se trouve la tombe de Benjamin Franklin.
Le dimanche 2 septembre, les frères assistent à la messe parmi la population catholique locale.
En cherchant dans les rues adjacentes, nous rencontrons bon nombre de personnes et quelques-unes, un livre à la main. Plus de doute, ce sont des catholiques; nous les suivons. L’église où nous entrons est la cathédrale dont la vaste nef ne tarde pas à être remplie de fidèles. Après un sermon en anglais, l’office divin s’achève au milieu d’un profond recueillement.
Le repos du dimanche est observé en Amérique. Tout commerce cesse et les familles peuvent se réunir, ce que nous faisons en passant notre dernière soirée avec Charles dans sa famille (t. 3: 667-668).
Le lundi 3 septembre, Leroy et le frère Joseph reviennent à New York à la gare centrale où le train pour Montréal les attend.
Nous voilà partis. Nous suivons la rive gauche de la grande rivière Hudson et nous la suivons ainsi […] jusqu’à Albany. Par une contrée des plus pittoresques, le fleuve suit son cours entre de petites collines où d’élégantes villas sont perchées à mi-côte, de rochers dont la crête ressemble à de vieux donjons démantelés, de villes manufacturières, de villages aux nombreuses usines.
Nous ne pouvons suivre la ligne ordinaire qui conduit directement à Montréal, nos 6 heures de retard mettent notre train en dehors de la circulation sur une voie constamment sillonnée par des convois réguliers.Au lieu de monter au Canada en suivant le lac Champlain, nous obliquons à gauche par la ligne des Adirondacks, pays boisé et d’un panorama tout particulier (t. 3: 671-672).
Le train stoppe sa course dans la gare de Windsor. Après une nuit passée dans un hôtel de Montréal, Leroy guide son compagnon pour une visite des établissements de la congrégation du 4 au 8 septembre. Il arrive à Saint-Césaire le 10 septembre 1906.
Saint-Césaire (septembre 1906-octobre 1907)
La vie au collège reprend son cours. Durant l’automne, l’établissement reçoit la visite d’un ancien élève devenu missionnaire au sein des Oblats de Marie-Immaculée61: Arthur Guertin62. Il vient prêcher une retraite de trois jours.

Figure 18Révérend père Arthur Guertin, O. M. I., 1904
Marie Auguste, frère, C.S.C. Historique de la paroisse de St-Césaire et de son collège, suivi du Rapport des fêtes du conventum, 1904, p. 127. BANQ, 0005515542.
[…] les paroles du zélé missionnaire sont tombées dans nos cœurs, comme dans une bonne terre où les semences germent, se développent et donnent au moissonneur les fruits de son travail (t. 3: 695).
Au mois de janvier 1907, Leroy se réjouit que le collège soit choisi comme résidence du juvénat de la congrégation.
Cette œuvre du juvénat est bien essentielle, surtout maintenant que les vocations religieuses sont battues en brèche dans différents pays. Voyez ce qui se passe dans notre malheureuse ancienne Mère Patrie! Après avoir envoyé autrefois ses missionnaires et ses religieux qui ont évangélisé le Canada, la France a expulsé de son sein tous ceux qui se dévouaient à l’éducation chrétienne (t. 4: 729-730).
La nostalgie est toujours bien présente chez le Français, notamment en début d’année.
On est tout étonné, autour de moi, de me voir, sinon gai, du moins jamais triste. Ils ne savent pas, mes chers Canadiens, que, cependant, je pleure souvent en cachette. J’appelle le mois de janvier le mois des larmes, et voici pourquoi.
De Noël à fin janvier, je reçois plus d’une centaine de lettres de mes anciens élèves, des enfants de mes élèves, des parents de mes anciens bijoux de 8e, et je vais être franc, des fiancées de mes anciens disciples qui désirent recevoir un mot du vieux professeur de celui qui va devenir leur époux.
Ces lettres sont si affectueuses, elles me rappellent tant de choses dans les jours où les fleurs poussaient sous mes pas, que j’éclate en sanglots en les lisant. Tout en faisant couler mes larmes, ces missives me font du bien, elles comblent le vide immense qui s’est creusé dans ma vie actuelle, si je la compare à celle de Neuilly; elles me tiennent compagnie, ces aimables correspondances, elles me disent en souriant: non, mon frère, vous n’êtes pas seul! (t. II, 94-95)
Le 29 mars 1907, l’homme de 67 ans est victime d’un malaise durant l’office. Affaibli, il reste alité dans l’infirmerie du collège. Le 7 avril, il reçoit une visite.
Le F. Emery vient me voir dans la matinée et, charitablement, m’avertit de me préparer à recevoir l’extrême onction […].
Je demande le R. P. Blais pour ma confession et le soir, entouré de tous mes confrères, ce même père m’administre le sacrement des mourants. Me recommandant aux prières de mes chers confrères, je leur fais mes adieux, en disant un mot à chacun d’eux […].
Je ne vois auprès de moi aucun de mes amis de France. Je pense à ma sœur Henriette […]. Pensées douloureuses […] (t. 4: 754-756).
S’ensuit une longue attente. Les jours passent et son état s’améliore progressivement. Le 23 avril, il peut enfin sortir et se promener quelques instants autour du collège. L’été est plus calme qu’à l’accoutumée. Après une retraite d’une semaine à Saint-Laurent, Leroy revient à Saint-Césaire, car il a besoin de repos et de tranquillité
(t. 4: 80). Le reste de la saison estivale est consacré à de courtes excursions sur la rive sud, notamment au mont Rougemont pour y pique-niquer.
Ses derniers mois sont un tournant, car il doit cesser l’enseignement après 36 ans de carrière.
C’est la première fois que je prends mes vacances dans le lieu même de ma résidence. Pendant mes 32 ans au collège de Neuilly, France, j’étais très occupé. Ma classe de huitième63, toujours nombreuse, en moyenne 35 élèves; mes sept heures de classe, chaque jour; ma surveillance et d’autres travaux nécessitaient un repos bien mérité. Mes supérieurs, très bons pour moi, ne m’ont jamais refusé ce repos des vacances, et même souvent l’ont provoqué.
Grâce à la bienveillance de mon père bien-aimé, de mon frère aîné, le frère Grégoire, […], j’ai pu visiter l’Italie en 1877 […]. La Belgique en 1883 avec mon frère Grégoire […]. L’Angleterre en 1889 avec mon cousin Thibault, ma cousine Alice […]. La Suisse en 1900 avec les mêmes […]. J’ai pu visiter la France depuis le Nord […] jusqu’aux Pyrénées […]. Jours heureux de ma jeunesse, vous passez comme un beau songe devant mes yeux! Mon beau et splendide voyage aux États-Unis, l’année dernière […] pouvait bien me servir pour deux ans.
Je ferai des voyages circulaires autour de ma chambre en contemplant le joli panorama que m’offre la montagne de Rougemont (t. 4: 790-794).
Il reste quand même responsable de l’œuvre du Sacré-Cœur de Jésus instituée à la fin du siècle précédent64.
Je ne m’ennuie pas, par la bonne raison que je ne connais pas l’ennui […]. L’œuvre du Sacré-Cœur, dont je suis chargé, me donne du travail pour la matinée parfois au-delà. Pendant la soirée, je lis, je prie, j’écris […]. Lorsque le temps le permet, je prends mon parapluie et un livre. Je vais du côté de Rougemont ou dans les prairies de la ferme du collège (t. 4: 795-796).
En octobre 1907, le décès d’un ancien élève lui rappelle son isolement, malgré la vie en communauté, et le fait qu’il a cru mourir sans revoir ses proches.
Mercredi 2 octobre 1907
Je suis très impressionné. Je viens d’assister à la messe de sépulture d’un charmant jeune homme de 24 ans, Paul Wilfrid Jarry, ancien élève du collège, le bien-aimé de tout le village. J’ai pleuré pendant tout l’office sans pouvoir sécher mes larmes. Je pensais à mes amis de France qui ont quitté cette terre sans que je puisse les revoir […]. Je pensais au vieux religieux français de Saint-Césaire qui a manqué de se trouver, lui aussi, couché dans son cercueil au mois d’avril dernier, sans avoir autour de lui aucun membre de sa famille.
Cérémonie très impressionnante chantée par les maîtres et les élèves du collège. Un usage canadien m’a beaucoup frappé. Quand un jeune homme de vingt et quelques années meurt, ce sont ses frères et ses amis qui portent le cercueil, mais les coins du drap mortuaire sont soutenus par des jeunes filles de 18 à 20 ans, habillées de blanc, si le temps le permet. Ce cortège fait une impression profonde […] (t. 4: 802-804).
Ainsi s’achève le journal d’Augustin Leroy. Il est cependant possible de suivre sa trace pour quelque temps encore grâce à ses deux carnets de notes personnelles.
Quelques fragments de vie à Saint-Césaire (octobre 1907-janvier 1910)
Au début de mars 1908, des encouragements lui parviennent une fois encore de son ancien supérieur à Neuilly: Quoique vous ne fassiez point la classe, vous rendez de très réels services là où vous êtes. Continuez toujours avec le même esprit d’abnégation
(Français à Leroy, 10/03/1908, PQ1.230).
Leroy trouve un réconfort moral dans cette correspondance.
Les lettres du T.R.P. Général ont le don de relever les courages abattus, de consolider les bonnes résolutions, d’affermir celui qui chancelle, de donner espoir à celui qui croit tout perdu, de diriger sûrement, de consoler ceux qui pleurent, de donner du cœur aux faibles, de l’ardeur aux combattants, de montrer le chemin de l’exil (t. II).
En juillet, il souligne la présence de marins français aux festivités liées au tricentenaire de la fondation de Québec (Courville et Garon, 2001: 324-325).
Nos marins français ont pu voir comment se comporte la fille de la vieille France, en venant aux fêtes de Québec. Ils peuvent faire la comparaison entre la liberté américaine et la liberté française; ce sont deux sœurs qui ne se ressemblent pas, je puis vous l’affirmer, moi qui ai vécu avec l’une et qui vis maintenant avec l’autre. Retenez bien que je n’ai pas divorcé, ce sont les F.-M.65 qui nous ont séparés (t. I).
L’automne est, comme chaque année, une période propice aux longues promenades.
Octobre 1908. Fermes canadiennes
Le jeudi, nous faisons de bonnes promenades dans nos belles campagnes et, si nous passons à côté d’une ferme, le propriétaire, en apercevant ces Messieurs du collège, ne manque pas de leur dire: entrez donc, nous allons fumer une pipe. Nous entrons. Mes confrères fument la pipe, et moi, je fais fumer une pomme en la croquant à belles dents. On boit un bon coup d’eau fraîche ou un verre de soda qu’une des jeunes filles nous présente, et l’on reprend la course interrompue.
Admirable intérieur que la ferme canadienne! C’est quelquefois une vraie ruche où s’agitent dix, quinze enfants autour d’une maman qui paraît aussi jeune que sa fille aînée!
Propreté des gens du nord, confortable américain, salon bien orné avec un goût français, piano dans un angle, violon sur une étagère. Les garçons reviennent du collège, les jeunes filles, du couvent. Les uns et les autres savent la musique, et le soir des longues veillées d’hiver, un concert improvisé fera sonner trop tôt l’heure du coucher (t. II).
Leroy séjourne au Nouveau-Brunswick entre le 27 juillet et le 23 août 1909. Il réside au collège Saint-Joseph de Memramcook que la congrégation a investi en 1864.
Nouveau-Brunswick, 15 août 1909
Les Acadiens célèbrent leur fête nationale le 15 août et, avec cette exubérance toute américaine, il y a procession, chars allégoriques, drapeaux – le drapeau français aux trois couleurs –, jeux sportifs, musique, illumination, feu d’artifice. Mais avant tout cela, grand-messe solennelle et discours patriotiques.
À Memramcook, il y a eu une réunion publique dans la salle des fêtes du collège des religieux de Sainte-Croix. Chant, musique, discours devant une assemblée de 7 à 800 personnes.
Figurez-vous qu’à un certain moment le président Gaudet66 se lève et annonce qu’il se trouve dans la salle un Français de France, le F. Marie-Auguste de Saint-Césaire, qui va monter sur le théâtre et dans son beau langage français va nous parler de notre ancienne mère patrie.
Un tonnerre d’applaudissements se fait entendre pendant que mon pauvre cœur se trouve serré comme dans un étau. Personne ne m’avait averti. Comment faire? Mes amis me regardent et m’encouragent. L’honneur de la France est en jeu. Je surmonte mon émotion – on pouvait l’être à moins –, je quitte ma place, les applaudissements redoublent. Je monte sur le théâtre et je parle de la France comme un bon fils sait parler de sa mère. Je fais part des impressions que je ressens au milieu d’un peuple fidèle à la cour britannique, mais dont le cœur ne peut se détacher de la France, puisque ce peuple, malgré toutes les persécutions, conserve la langue française et le drapeau français… Je termine en parlant de Jeanne d’Arc et je demande une prière pour la France afin que le Bon Dieu lui rende la paix religieuse. M. le président vient me serrer la main et veut me faire asseoir à ses côtés. Je le remercie et je retourne au milieu de mes amis qui m’appellent à leur tour. J’étais en nage et, trois heures après mon improvisation, j’avais encore le trac… J’avais été trahi par un de mes amis (t. II).
L’année 1910 est l’occasion de souligner l’anniversaire de son arrivée au Canada.
Sept ans déjà me séparent de ma France bien-aimée, et je peux affirmer que ces nombreux jours ont passé avec rapidité. C’est dire que j’ai trouvé sur la terre canadienne une hospitalité très amicale qui, sans faire oublier la patrie, atténue au moins la douleur de la séparation (t. II).
Curieusement, Leroy n’évoque pas sa nouvelle vie à Montréal qui débute en janvier 1910. Seuls quelques mots dans les dernières pages de son second carnet de notes trahissent son changement de situation: Le Mont Royal, le charme des yeux, le but favori des promenades (t. II).
Épilogue
Le 21 novembre 1913, Augustin Leroy reçoit une lettre du supérieur du collège de Neuilly67 qui lui demande s’il accepterait d’écrire un ou plusieurs articles dans lesquels il évoquerait l’histoire de l’établissement scolaire ainsi que son parcours personnel, afin que les élèves se sentent en dépendance d’un passé dont ils profitent encore
(ACSC-Montréal, PQ1.230).

Figure 19L’Oratoire Saint-Joseph du mont Royal vers 1911
Archives de l’Oratoire Saint-Joseph du mont Royal.
Leroy rédige sa réponse le 12 décembre suivant. Cette dernière apporte un certain éclairage sur les raisons qui l’ont poussé à cesser d’écrire régulièrement, au moins pour les années 1910-1918.
Je ne suis plus jeune, mes 25 ans sont bien usés. Sur mes épaules s’accumule déjà un grand nombre d’années, et ce poids qui commence à devenir lourd (l’exil ne l’a point allégé) descend parfois dans la plume de l’écrivain.
En arrivant au Canada, en 1903, j’ai continué dans notre collège de Saint-Césaire ce que j’aimais tant à Neuilly, la classe, et j’avais alors quelques loisirs. Mais en janvier 1910, je fus appelé par mes supérieurs à Montréal afin de prendre la charge de secrétaire de l’Oratoire Saint-Joseph. Depuis ce moment, les loisirs me sont inconnus […].
Et puis, je vous l’avoue franchement, M. le Supérieur, mes souvenirs se sont noyés dans mes larmes. Pour faire un historique exact de Sainte-Croix de Neuilly, il faut des dates précises, des notes. Des notes surtout, que le vent de la tempête de 1903 a dispersées. Écrire une lettre n’est rien, les idées précèdent la plume; mais faire une histoire aussi mouvementée que celle des religieux de Sainte-Croix de Neuilly, la plume attendrait les idées qui, souvent, ne viendraient pas.
Il m’est donc impossible d’entreprendre le travail que vous me demandez, le temps et les matières me manquent absolument […] (ACSC-Montréal, PQ1.230).
Ce refus peut étonner au regard du profond sentiment d’attachement de Leroy envers le collège de Neuilly et de son goût pour l’écriture. Cependant, sa réponse témoigne d’un passage effectif d’une vie à une autre.
La première est celle d’un religieux-enseignant au collège et ressemble – hormis la séparation de ses proches – à la vie qu’il menait en France avant son départ, alors que la seconde le plonge à un âge avancé dans une tâche administrative exigeante et inconnue jusque-là, au point de lui faire abandonner définitivement l’écriture. Depuis l’été 1903, celle-ci servait avant tout l’ambition principale du religieux français: dire l’exil.
Le parcours canadien d’Augustin Leroy tel qu’il apparaît dans son journal personnel est l’expression d’une mise en récit qui s’articule autour de deux dimensions distinctes, mais complémentaires. La première se situe à une échelle collective et se manifeste par des références, nombreuses et régulières, à son passé neuilléen. En choisissant de se rendre au Canada pour préserver sa vocation, le religieux quitte une communauté dans laquelle ses racines sont anciennes. Congréganiste depuis 1856 et professeur au collège de Neuilly depuis 1871, Leroy est très bien intégré et reconnu dans sa famille religieuse. Il correspond très régulièrement avec ses confrères et notamment avec le supérieur général, garant de l’unité communautaire à l’heure où les vocations, même les plus sûres, peuvent vaciller. Ainsi, les souvenirs de la vie religieuse passée de Leroy jalonnent son récit, malgré les années qui s’écoulent, et alimentent la profonde nostalgie qui l’habite. La seconde dimension est individuelle et concerne davantage la vie privée de Leroy. Dans ses écrits, il évoque de nombreux souvenirs personnels qui laissent entrevoir que, malgré les contraintes de la vie communautaire, il entretenait des relations familiales et amicales suivies. Ainsi, lorsqu’il opte pour l’exil, Augustin Leroy n’est pas un religieux accoutumé au fait d’être séparé des membres de sa famille, comme on pourrait s’y attendre de la part d’un congréganiste. Cet élément est particulièrement important pour comprendre le sentiment d’isolement qui affleure tout au long de son récit, comme peuvent le ressentir bien des migrants loin des leurs. C’est là la richesse singulière de ce journal qui, comme son auteur, se situe à la croisée des expériences du voyage, de l’exil et de la migration.
Notes
- Au début du xxe siècle, la politique anticléricale des républicains – au pouvoir depuis 1879 – atteint son paroxysme. En 1901, la Loi sur les associations, bien qu’elle ne concerne pas exclusivement les congrégations, oblige ces dernières à obtenir une autorisation si elles n’en possèdent pas déjà pour poursuivre leurs activités et ouvrir de nouveaux établissements. Au mois de mars 1903, les demandes des congrégations masculines sont massivement refusées par le Sénat (60 sur 65). La loi de 1904
relative à la suppression de l’enseignement congréganiste
complète celle de 1901 en interdisant toute activité d’enseignement aux congréganistes, y compris les congrégations autorisées, qui n’avaient pas eu besoin d’effectuer une demande en 1901. La séparation des Églises et de l’État qui intervient en 1905 est l’aboutissement de cette politique (Sorrel, 2003: 77-143; Delpal, 2005: 66-67). - Nous remercions Yves Frenette (Université de Saint-Boniface), Gérard Fabre (CNRS) et Serge Jaumain (Université libre de Bruxelles) pour leur confiance et plus particulièrement le premier pour ses commentaires avisés.
- Il est le fils d’Henri Leroy et de Madeleine Morin. ADSarthe, registres de Mézeray, BM, N1833-1854, cote 5Mi 206_10-vues 111-112.
- L’autographie est un procédé d’imprimerie qui se développe dans la première moitié du xixe siècle et qui consiste à transposer sur une pierre lithographie des dessins réalisés sur un papier avec une encre grasse. Cette technique permet notamment d’éviter de passer par la gravure.
- Les références aux quatre tomes du journal personnel d’Augustin Leroy Quelques notes sur le voyage d’un religieux exilé: de France au Canada seront dorénavant indiquées ainsi: t. 1, t. 2, t. 3 et t. 4.
- Henry Leroy (1822-1900) entre en religion (frère Grégoire) en 1836 et assume diverses fonctions au sein de la congrégation de Sainte-Croix, notamment comme économe général et assistant général (ACSC – Montréal, PX4-6/30).
- Préparés à cette issue, les religieux demeurent sur place jusqu’au dernier moment et reçoivent la visite et le soutien d’anciens élèves et de leurs familles (L’Univers, 29/06/1903). De leur côté, les élèves manifestent leur mécontentement devant le Cercle catholique du Luxembourg et la chambre des députés à Paris (La Croix, 30/06/1903).
- Nous corrigeons les coquilles et les fautes d’orthographe des extraits cités. Les éventuelles erreurs commises par Leroy sont également rectifiées.
- Ignace Bourget (1799-1885) succède à Jean-François Lartigue à la tête du diocèse de Montréal (Perin, 2008). Durant son épiscopat, soit entre 1840 et 1876, il joue un rôle essentiel dans le recrutement et l’installation au Québec de congrégations religieuses françaises, à l’instar des Oblats de Marie-Immaculée (1841), des Jésuites (1842), des Dames du Sacré-Cœur (1842), des religieuses du Bon-Pasteur (1844), des religieux de Sainte-Croix (1847), des Marianites de Sainte-Croix (1847) et des Clercs de Saint-Viateur (1847) (Balloud, 2019).
- Alfred Bessette (1845-1937), en religion frère André, entre dans la congrégation de Sainte-Croix en 1870. En tant que frère convers, il exerce la fonction de portier au collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Côte-des-Neiges, près de Montréal. Sa grande disponibilité envers les malheureux et les malades et sa réputation de thaumaturge lui valent un vaste succès populaire. La statue de Saint-Joseph qu’il a installée sur le mont Royal devient rapidement un lieu de prière. Un premier sanctuaire – l’oratoire Saint-Joseph – est érigé en 1904. Celui-ci est agrandi entre 1908 et 1914, avant que la construction de la future basilique débute en 1915 (Robillard, 2005a et 2005b).
- Nouvellement créées, elles sont publiées mensuellement jusqu’en 1943, date à laquelle elles sont remplacées par L’Oratoire.
- Le Mans, La Flèche, Mezeray et Roézé (Sarthe), et Baugé (Maine-et-Loire).
- Liancourt-Saint-Pierre (Oise), Gisors (Eure), Chaumont (Haute-Marne) et Sancourt (Nord).
- Aujourd’hui dans les Yvelines.
- Yves-Marie Lepage (1837-1920) entre en religion au sein de la congrégation de Sainte-Croix en 1865. Il est ordonné prêtre un an plus tard et officie en Bretagne et dans la Sarthe avant de rejoindre le Canada en 1903. Il œuvre notamment à Saint-Laurent, à Saint-Césaire et à Sorel où il occupe la fonction d’aumônier. Il demeure au Québec jusqu’à son décès à Montréal en 1920. ACSC-Montréal, PX4-6/30.
- Henri Picot (1873-1956), en religion frère Paul de la Croix, intègre les frères de Sainte-Croix en 1891. Avant son départ en Amérique du Nord, il occupe la fonction de surveillant au collège Sainte-Croix de Neuilly. Il demeure au Canada de 1903 à 1914. ACSC-Montréal, PX4-6/31.
- Jean-Marie Guérin (1873-1943), en religion frère Augustin-Marie, entre en religion en 1896. En France, avant son départ, il est surveillant, puis professeur au pensionnat de Meslay (Loir-et-Cher). Au Canada, il dirige notamment le Juvénat Saint-Joseph (Saint-Césaire) de 1908 à 1926. Il décède à Montréal en 1943. ACSC-Montréal, PX4-6/31.
- Jean-Jacques Nanquette (1807-1861) est ordonné prêtre en 1830 et officie dans l’archidiocèse de Reims. Il est consacré évêque du Mans le 11 novembre 1855 et décède, en exercice, six ans plus tard (Lejay, 1881).
- Le regard que porte Leroy sur la nature et sa mise en récit rappellent le romantisme de Chateaubriand – lui-même animé par la pensée physico-théologique de Bernard Nieuwentijdt – où la mer occupe une place toute particulière (Pinel, 2003: 11-34). En l’occurrence, il s’agit du Génie du christianisme dont le livre cinquième est consacré à l’
existence de Dieu, prouvée par les merveilles de la nature
. Dans celui-ci, le Malouin présente la mer, observée depuis le vaisseau sur lequel il passe en Amérique en 1791, comme l’une des deux perspectives de la nature – l’autre est terrestre – qui forment un tout harmonique quidit tant de choses de la Providence
(Chateaubriand, 1826: 252). - Un quai a été aménagé en 1902 et un phare suivra sept ans plus tard pour répondre aux besoins du trafic fluvial en pleine expansion.
- Après avoir été une des portes d’entrée les plus importantes d’Amérique dans la première moitié du xixe siècle, le port de Québec devient progressivement une étape, un port de passage, avec l’amélioration des conditions de navigation sur le Saint-Laurent qui permet aux navires de fort tonnage de rejoindre Montréal – notamment par le dragage et le creusement du chenal naturel qui existe entre les deux villes à partir de 1854 –, pour son plus grand profit, puis la région des Grands Lacs (Courville et Garon, 2001: 180-181).
- Le sentiment d’appartenance lié aux caractères français et catholique des campagnes canadiennes est très répandu parmi les voyageurs français qui les découvrent pour la première fois (Simard, 1987: 121).
- La congrégation de Sainte-Croix a acheté le terrain et l’hôtel Bellevue qui s’y trouvait en 1869. La destruction de l’hôtel intervient en 1881, puis suit l’édification des différentes sections du collège et celle de la chapelle en 1888. Huit ans plus tard, la communauté acquiert également une propriété attenante qui devient ultérieurement le parc Saint-Joseph. De son côté, le scolasticat est reconstruit entre 1907 et 1908 (Rumilly, 1969).
- Georges-Auguste Dion (1852-1918) prend l’habit religieux en 1873 à Montréal. Au sein de la congrégation de Sainte-Croix, il est d’abord professeur (Saint-Laurent, Farnham), puis supérieur provincial entre 1896 et 1912 (Bessette, 1998).
- Les Dominicains s’implantent à Saint-Hyacinthe en 1873 (Hudon, 1996: 173).
- Eugène Lhumeau (1860-1939), frère Raphaël en religion, entre en religion en 1885 et occupe le poste de maître d’études au collège Sainte-Croix de Neuilly lorsqu’il décide de rejoindre le Canada en 1903. Il demeure six ans à Montréal avant de rejoindre la procure de Rome où il exerce la fonction d’économe jusqu’en 1920, date à laquelle il retourne en France. ACSC-Montréal, PX4-6/31.
- La congrégation de Sainte-Croix déplace son noviciat (jusqu’ici installé à Côte-des-Neiges) dans l’ancien collège de Sainte-Geneviève en 1893 – confié aux religieux en 1881 – où il demeure jusqu’en 1932 (CSC, 1947: 201-2012). Il s’agit de l’éloigner de tout établissement scolaire pour que les jeunes recrues puissent suivre leur formation dans un cadre plus calme où ils ne seront pas sollicités pour des obédiences temporaires, notamment pour des classes.
- Le funiculaire est construit entre 1876 et 1885. Il permet aux visiteurs d’atteindre le parc du mont Royal depuis le pied de la montagne (Dagenais, 2006: 25-30).
- Renégat et martyr: drame en trois actes est une pièce du père Camille de la Croix (1831-1911), un père jésuite belge.
- La réserve mohawk de Kahnawake est fondée en 1667 sous le nom de Mission Saint-François-Xavier du Sault-Saint-Louis. Cette mission jésuite est initialement établie à Kentake (aujourd’hui aux environs de La Prairie) et ne connaît son emplacement actuel qu’au début du xviiie siècle (Sossoyan, 2009; Lozier, 2018).
- Jean-Marie Guyot (1846-1929), en religion frère Marie-Antoine, est en fonction au collège Sainte-Croix de Neuilly avant son départ pour le Canada en 1903. Il œuvre notamment comme professeur au collège Notre-Dame. ACSC-Montréal, PX4-6/31.
- Arthur Melançon (1863-1941), prêtre jésuite canadien-français. Il consacre une large partie de sa carrière à la mission de Caughnawaga (Kahnawake) avant de devenir archiviste au collège Sainte-Marie de 1910 à 1940.
- Un baiser-de-paix est une petite plaque (de métal, d’ivoire ou de bois sculpté) ornée de motifs religieux (souvent une scène de la vie du Christ) que le prêtre donne à baiser aux fidèles à la fin de la messe.
- Leroy commet une erreur: la Société Saint-Jean-Baptiste est fondée 1834.
- Kateri Tekakwitha est une jeune autochtone convertie au christianisme au xviie siècle (Greer, 2007). Elle est béatifiée le 22 juin 1980 par Jean-Paul II, puis canonisée le 21 octobre 2012 par Benoît XVI.
- Théodore Botrel (1868-1925) est un chansonnier breton connu pour être à l’origine du mouvement La Bonne Chanson qui cherche à moraliser la chanson en valorisant le terroir. Patriote, catholique et conservateur, il visite le Québec en 1903 et en 1922 où il bénéficie d’un accueil favorable, notamment de la part des milieux traditionalistes (Hellégouarch, 2009). Son œuvre trouve un écho au Québec grâce à la fondation de la société d’édition La Bonne Chanson par Charles-Émile Gadbois, un prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe (De Surmont, 2001).
- Leroy commet une nouvelle erreur: la première visite de Botrel a lieu en 1903.
- Très révérend père.
- Le Chapitre général est l’assemblée à intervalles réguliers de tous les membres – ou de leurs représentants (par province) – d’un institut de vie consacrée (un groupe de femmes ou d’hommes qui vit ensemble sur la base de vœux individuels et d’une règle collective). Chacun d’eux l’organise selon la règle qui lui est propre.
- L’Université Notre-Dame-du-Lac (South Bend, Indiana) est fondée en 1842 par Édouard Sorin (1814-1893), un prêtre français de la congrégation de Sainte-Croix.
- Émile Combes (1835-1921) est président du Conseil entre le 7 juin 1902 et le 24 janvier 1905. Il mène une politique résolument anticléricale. Le 25 juillet 1902, il ordonne dans une circulaire ministérielle la suppression d’environ 2 500 congrégations non autorisées (à la suite de la Loi sur les associations de juillet 1901). En 1903, les autres demandes d’autorisation sont majoritairement refusées par le Parlement. En 1904, une nouvelle loi, dite
loi Combes
, interdit notamment l’enseignement aux congrégations religieuses (Curtis, 2003). L’œuvre dupetit père Combes
lui vaut un ressentiment tenace au sein de l’Église et plus largement parmi la population catholique. - Le séisme de San Francisco a lieu le 18 avril 1906 et provoque un vaste incendie qui détruit une large partie de la cité californienne.
- La catastrophe de Courrières a lieu le 10 mars 1906 et cause la mort de 1099 mineurs (Varaschin, 2007: 109-124).
- L’éruption du Vésuve se déroule du 4 avril 1906 au 21 avril 1906.
- Il s’agit des élections législatives françaises qui ont lieu du 6 au 20 mai 1906. Elles reconduisent la majorité – de gauche – sortante qui s’appuie principalement sur le Parti républicain radical et radical-socialiste et l’Alliance républicaine démocratique.
- Depuis les expulsions de 1903, les frères trop âgés ou infirmes demeurent en résidence à Angers (Maine) aux côtés du provincial et de ses assistants (Laperrière, 1999: 380).
- Souvent au nombre de deux, les assistants généraux appuient le supérieur général dans ses tâches.
- Armand de Charbonnel (1802-1891) est un prêtre sulpicien français qui devient évêque de Toronto en 1850 (Nicolson et Moir, 1990).
- Leroy commet une erreur: la capitale de l’État du Michigan est Lansing.
- Frères Victorien, Cécilien, Marie-Auguste, Léonide, Joseph, Célestin, Ernest, Georges et Louis.
- Édouard Sorin (1814-1893) est ordonné prêtre en 1838 avant de rejoindre la congrégation de Sainte-Croix, au Mans (Sarthe, France), deux ans plus tard. En 1841, il prend la route des États-Unis à la tête d’un groupe de religieux à l’appel de l’évêque du diocèse de Vincennes (Indiana) qui souhaite la création d’écoles. C’est là, près de South Bend, que le père Édouard Sorin fonde un petit collège qui deviendra l’Université Notre-Dame-du-Lac dont il est le premier président jusqu’en 1865. En 1868, il devient supérieur général de la congrégation et occupe cette fonction jusqu’à sa mort en 1893 (Lemarié, 1978).
- Les frères coadjuteurs (ou convers) sont chargés des travaux manuels et des tâches domestiques au sein d’une congrégation religieuse.
- En 1889, le Holy Cross Seminary remplace le premier noviciat fondé par Édouard Sorin en 1852 pour permettre le recrutement et la formation de futurs religieux. Le nouveau séminaire accueille les jeunes hommes qui se préparent à devenir prêtre et les forme en conséquence.
- En 1880, il devient curé de la ville de Besançon (Indiana), jusqu’à sa mort en 1893 (ACSC-Montréal, PX4-6/30).
- Hippolyte Marinoni (1823-1904) est un mécanicien, inventeur et constructeur de presses à imprimer. Il conçoit plusieurs modèles de presses rotatives qui permettent d’augmenter rapidement le tirage des journaux. En 1872, il fournit au journal La Liberté la première presse rotative de France avec un tirage régulier de 40 000 exemplaires à l’heure. À partir de 1882, il devient patron de presse en succédant à Émile Girardin à la tête du Petit journal. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des pères de la presse moderne (Le Ray, 2009)
- La grotte de Massabielle (ou grotte de Lourdes) est un lieu de pèlerinage situé à Lourdes dans le département français des Hautes-Pyrénées.
- Saint Mary’s College est fondé en 1844 par les Sœurs de Sainte-Croix, une communauté religieuse féminine issue de la congrégation de Sainte-Croix.
- Il s’agit certainement de la compagnie Studebaker, fondée en 1852 à South Bend.
- Francis Frederick Linneborn (1864-1915) est ordonné prêtre en 1889, puis évêque de Dacca au Bengale oriental (Bangladesh) en 1909 où il demeure jusqu’à sa mort en 1915. Les missionnaires de Sainte-Croix y œuvrent depuis 1853.
- Il y en a quatre, dédiées à la discipline régulière, aux études, à la comptabilité et aux affaires en litige. Chacune travaille de manière autonome et prépare des rapports liés à son domaine de compétence.
- Congrégation religieuse fondée en 1816 à Marseille (France) et qui s’implante au Canada à partir de 1841.
- Arthur Guertin est né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (Québec), le 2 mai 1868. Après un passage au collège de Saint-Césaire, il entre au noviciat de Lachine en 1885 et prononce ses premiers vœux le 8 septembre 1886. Il fait son oblation perpétuelle au scolasticat Saint-Joseph à Ottawa et est ordonné prêtre le 24 avril 1892 dans la même ville. Après quelques mois de vicariat à Notre-Dame de Hull (1892), il œuvre comme missionnaire-prédicateur à Saint-Pierre-Apôtre de Montréal (1892-1907), puis à Saint-Sauveur de Québec (1907-1910). Il prêche au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans les collèges afin de susciter des vocations. En 1916, il devient professeur d’histoire du Canada et de littérature française à l’Université d’Ottawa jusqu’à sa mort le 23 juillet 1932 (Morisseau, 1942).
- L’équivalent de la 3e année au Québec.
- Cette œuvre de dévotion religieuse débute au collège de Saint-Césaire sous le premier supériorat (1890-1898) du père Léonard Bissonnette. En effet, à la suite de plusieurs guérisons jugées miraculeuses au sein de l’établissement scolaire, ce dernier décide d’élever une chapelle votive au Sacré-Cœur en 1896 (CSC, 1947, 224).
- Les francs-maçons.
- Il s’agit certainement d’Édouard Gaudet, médecin à Memramcook à partir de 1902 (Le Moniteur acadien, 28/01/1909).
- Il s’agit de Pierre Petit de Julleville (1876-1903), alors prêtre séculier.
Bibliographie
Sources
- Registres de Mézeray, BM, N1833-1854, cote 5Mi 206_10-vues 111-112. Archives départementales de la Sarthe (ADSarthe).
- Fonds Augustin Leroy. Archives de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (ACSC- Montréal), PQ1.230 et PQ235.
- Augustin Leroy (frère Marie-Auguste). Quelques notes sur le voyage d’un religieux exilé: de France au Canada. 4 vol., 804 p. (pagination continue), ACSC-Montréal, Q235e-h.
- Augustin Leroy (frère Marie-Auguste). Notes personnelles. 2 vol., ACSC-Montréal, Q235i-j.
- Chateaubriand, François-Renée de (1826 [1802]). Œuvres complètes, t. XI. Génie du christianisme, t. I. Paris: Ladvocat éditeur.
- Congrégation de Sainte-Croix (1947). Sainte-Croix au Canada, 1847-1947. Montréal: Imprimerie Saint-Joseph.
- Congrégation de Sainte-Croix (1981). Sainte-Croix en France, les Pères et les Frères. ACSC-Montréal, PX4-6/30 et 31.
- Leroy, Augustin (frère Marie-Auguste) (1904). Historique de la paroisse de Saint-Césaire et de son collège; suivi du Rapport des fêtes du conventum des 20, 21, 22 juin 1904. Montréal: La Patrie.
Journaux
- La Croix, 1903
- La Patrie, 1903
- Le Moniteur acadien, 1909
- L’Univers, 1903
Études
- Balloud, Simon (2020).
L’expérience de la mobilité dans les journaux de voyage des religieux français en exil au Canada
, dans Yves Frenette, Christine Nougaret et Isabelle Monnin (dir.). Dans leurs propres mots: la mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, xive-xxe siècles, Winnipeg: Presses universitaires de Saint-Boniface, p. 155-176. - Balloud, Simon (2019). Les hommes d’Église français dans la migration vers le Canada, 1842-1914. Thèse de doctorat (histoire), Université de La Rochelle / Université du Québec à Montréal.
- Bergerat, Émile (1884). Bébé et Cie. Paris: Klein et Cie éditeurs.
- Bergeron, Henri-Paul (1995). Basile Moreau: fondateur des congrégations de Sainte-Croix, frères, pères, sœurs. Paris: Fides.
- Bessette, Roger (1998).
Dion, Georges-Auguste
, dans Dictionnaire biographique du Canada, t. 14, Université Laval/University of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/dion_georges_auguste_14F.html. - Bienvenue, Louise (2009).
Former à l’académie commerciale ou collège classique? Un débat sur l’enseignement secondaire des garçons au début des années 1920
. Revue d’histoire de l’éducation / HER, t. 21, no 1, p. 4-23. - Cabanel, Patrick, et Dominique Durand (dir.) (2005). Le Grand Exil des congrégations religieuses françaises (1901-1914). Actes du colloque international tenu à l’Université Jean-Moulin-Lyon III (Lyon, 12-13 juin 2003). Paris: Cerf.
- Cabanel, Patrick (dir.) (2008). Lettres d’exil, 1901-1909. Les congrégations françaises dans le monde après les lois laïques de 1901 et 1904: anthologie de textes missionnaires. Turnhout: Brepols.
- Chapuis, Olivier (2017). Le naufrage de La Bourgogne, 4 juillet 1898: fabrication d’un événement médiatique émotionnel. Mémoire de maîtrise (histoire), Université Grenoble Alpes.
- Corbin, Alain (2014). Le ciel et la mer. Paris: Flammarion.
- Courville, Serge, et Robert Garon (dir.) (2001). Québec: ville et capitale. Sainte-Foy: Presses de l’Université Laval.
- Croteau, Georges (1996). Les frères éducateurs, 1920-1965: promotion des études supérieures, modernisation de l’enseignement public. La Salle: Hurtubise HMH.
- Curtis, Sarah A. (2003). L’enseignement au temps des congrégations: le diocèse de Lyon (1801-1905), Lyon: Presses universitaires de Lyon.
- Dagenais, Michèle (2006). Faire et fuir la ville: espaces publics de culture et de loisirs à Montréal et Toronto aux xixe et xxe siècles. Québec: Les Presses de l’Université Laval.
- Delpal, Bernard (2005),
L’application des lois anti-congréganistes: éléments pour un bilan, 1901-1914
, dans Patrick Cabanel et Jean-Domonique Durand (dir.). Le Grand Exil des congrégations religieuses françaises (1901-1914). Actes du colloque international tenu à l’Université Jean-Moulin-Lyon III (Lyon, 12-13 juin 2003). Paris: Cerf, p. 59-87. - De Surmont, Jean-Nicolas (2001). La Bonne Chanson: le commerce de la tradition en France et au Québec dans la première moitié du xxe siècle. Montréal: Triptyque.
- Dolan, Jay P. (1985). The American Catholic Experience: A History from Colonial Times to the Present. Garden City: Doubleday.
- Dubé, Philippe (1986). Deux cents ans de villégiature dans Charlevoix: l’histoire du pays visité. Sainte-Foy: Presses de l’Université Laval.
- Duret, Théodore (1906). Histoire des peintres impressionnistes: Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin. Paris: H. Floury.
- Gordon, Peter, et David Gordon (2005). Musical Visitors to Britain. Londres et New York: Routledge.
- Greer, Allan (2007). Catherine Tekakwitha et les Jésuites: la rencontre de deux mondes. Montréal: Boréal.
- Hellégouarch, Solenn (2009). De la Bretagne au Québec: le succès de Théodore Botrel (1868-1925), chansonnier breton. Mémoire de maîtrise (musicologie), Université de Montréal.
- Hudon, Christine (1996). Prêtres et fidèles dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, 1820-1875. Sillery: Septentrion.
- Jasen, Patricia (1995). Wild Things: Nature, Culture, and Tourism in Ontario, 1790-1914. Toronto: University of Toronto Press.
- Kelley, Ninette, et Michael Trebilcock (1998). The Making of the Mosaic: A History of Canadian Immigration Policy. Toronto: University of Toronto Press.
- Laperrière, Guy (1996-2005). Les congrégations religieuses: de la France au Québec, 1880-1914. Sainte-Foy: Presses de l’Université Laval, 3 vol.
- Lejay, Abbel (1881). Vie de monseigneur Nanquette, évêque du Mans. Besançon: Jacquin.
- Lemarié, Charles (1978). De la Mayenne à l’Indiana: le père Édouard Sorin. Angers: Université catholique de l’Ouest.
- Le Ray, Éric (2009). Marinoni: le fondateur de la presse moderne (1823-1904). Paris: L’Harmattan.
- Lozier, Jean-François (2018). Flesh Reborn. The Saint Lawrence Valley Mission Settlements through the Seventeenth Century. Montréal et Kingston: McGill-Queen’s University Press.
- Lyon-Caen, Judith (2016).
Le “je” et le baromètre de l’âme
, dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir). Histoire des émotions. Tome 2: Des Lumières à la fin du xixe siècle. Paris: Éditions du Seuil, p. 169-188. - Morisseau, Henry, o.m.i. (1942). Un apôtre canadien: le père Arthur Guertin, missionnaire Oblat de Marie-Immaculée, 1868-1932. Ottawa: Éditions de l’Université d’Ottawa.
- Nicolson, Murray W., et John S. Moir (1990).
Charbonnel, Armand-François-Marie De
, dans Dictionnaire biographique du Canada, t. 12, Université Laval/University of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/charbonnel_armand_francois_marie_de_12F.html. - Perin, Roberto (2008). Ignace de Montréal: artisan d’une identité nationale. Montréal: Éditions du Boréal.
- Pinel, Marie (2003). La mer, miroir d’infini: la métaphore marine dans la poésie romantique. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Robillard, Denise (2005a). Les merveilles de l’Oratoire: l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 1904-2004. Montréal: Fides.
- Robillard, Denise (2005b).
Bessette, Alfred, dit frère André
, dans Dictionnaire biographique du Canada, t. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003-, http://www.biographi.ca/fr/bio/bessette_alfred_16F.html. - Rumilly, Robert (1969). Cent ans d’éducation: le collège Notre-Dame, 1869-1969. Montréal: Fides.
- Simard, Sylvain (1987). Mythe et reflet de la France: l’image du Canada en France, 1820-1914. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa.
- Simon, Jean (1952).
Jacques-Émile Blanche et l’Angleterre
. Revue de littérature comparée, t. 26, p. 183-201. - Sorrel, Christian (2003). La République contre les congrégations: histoire d’une passion française (1899-1914). Paris: Cerf.
- Sossoyan, Matthieu (2009).
Les Indiens, les Mohawks et les Blancs: mise en contexte historique et sociale de la question des Blancs à Kahnawake
. Recherches amérindiennes au Québec, 39 (1-2), p. 159-171. - Taylor, Philip S. (2007). Anton Rubinstein: A Life in Music. Bloomington: Indiana University Press.
- Turcotte, Paul-André (1988). L’enseignement secondaire public des frères éducateurs, 1920-1970. Montréal: Éditions Bellarmin.
- Varaschin, Denis (dir.) (2007). Risques et prises de risques dans les sociétés industrielles, Bruxelles: Peter Lang.
Sources cartographiques
Source principale
- Augustin Leroy (frère Marie-Auguste). Quelques notes sur le voyage d’un religieux exilé: de France au Canada. 4 vol., 804 p. (pagination continue), ACSC-Montréal, Q235e-h.
Sources secondaires
- Limites provinciales en 1911, adaptées du Projet Échantillon du recensement du Canada en 1911 - IRCS/CCRI.
- SICZEWICZ, Peter (2011). U.S. Historical States and Territories. Emily Kelley, digital comp. Données tirées de l’Atlas of Historical County Boundaries, John H. Long (ed.). Chicago: The Newberry Library. Disponible en ligne: http://publications.newberry.org/ahcbp.
Tous droits réservés. Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)
Dépôt légal (Québec et Canada), 3e trimestre 2023.
ISBN 978-2-921926-95-9 (PDF)
Crédits
- RÉVISION LINGUISTIQUE – Solange Deschênes
- Conception graphique – Émilie Lapierre Pintal
- Coordination – Sophie Marineau
- Cartographie – Émilie Lapierre Pintal, Louise Marcoux (Département de géographie, Université Laval) et Jean-François Hardy
- Programmation – Adam Lemire avec la collaboration de Tomy Grenier et Jean-François Hardy
Comment citer cette publication
BALLOUD, Simon (2022). «Augustin Leroy, un religieux français en exil en Amérique du Nord (1903-1918)» dans , Gérard Fabre et Yves Frenette (dir.), Les récits de voyage et de migration comme modes de connaissance ethnographique: Canada, États-Unis, Europe (XIXe-XXe siècles). Québec: Centre interuniversitaire d'études québécoises (coll. «Atlas historique du Québec» - La francophonie nord-américaine). [En ligne]: https://atlas.cieq.ca/la-francophonie-nord-americaine/interactif/augustin-leroy-un-religieux-francais-en-exil-en-amerique-du-nord-1903-1918.html (consulté le 19 février 2026).